SOUVENIR, SOUVENIR
Le vendredi 12 septembre 2014, à la demande de l’université d’Artois, j’ai apporté mon concours au séminaire Les grands témoins de la critique et de la promotion des livres pour la jeunesse. Le retranscription initiale peut être retrouvée dans le numéro 36 des « Cahiers Robinson » consacré au livre de poche, bibliothèque de la jeunesse. Ci-après, la première partie de ma communication qui pose les prémisses de la question.
Promouvoir la littérature pour la jeunesse : les petits cailloux blancs du bénévolat (première partie)
Il va être question dans ma communication de bénévolat et de littérature pour la jeunesse.
Fouillant dans ma mémoire (autant voire plus que dans mes cartons) pour rassembler des éléments propres à documenter ce double sujet, l’envie m’a pris de ne pas « glisser sous le tapis » ce que j’appellerai, faute d’avoir trouvé mieux, les prémisses de la question.
Quelques souvenirs anciens donc pour commencer, à propos de lecture (beaucoup) et de bénévolat (à peine), situés entre mes années d’enfance et la fin de mes études à L’École normale d’Arras puis d’Orléans – propos introductifs un tantinet en marge du sujet, j’en conviens.
Lectures hasardeuses ou pas
La lecture, les livres et les journaux n’avaient pas une place centrale à la maison.
Mon père, né dans une famille modeste, à Bourbourg-Campagne, route de Gravelines, a fréquenté l’école jusqu’à sa douzième année. Il n’en parlait pas. Je l’ai très rarement vu un livre à la main. Il achetait parfois le journal – Nord-Matin et non La Voix du Nord – que je lui empruntais à cause de Monsieur Subito, de Pépito et du Cavalier inconnu.
 Ma mère, qui avait son brevet élémentaire, lisait plus volontiers, des livres parfois, dont les miens ou ceux de mes sœurs, des hebdomadaires féminins assez souvent. Elle me prêtait quand je lui demandais, par curiosité plus que pour le travail, le Tout en un, encyclopédie illustrée des connaissances humaines publié par la librairie Hachette, épais volume de près de 1500 pages, qu’elle avait reçu en cadeau de fin de scolarité. Elle achetait régulièrement Télé 7 jours.
Ma mère, qui avait son brevet élémentaire, lisait plus volontiers, des livres parfois, dont les miens ou ceux de mes sœurs, des hebdomadaires féminins assez souvent. Elle me prêtait quand je lui demandais, par curiosité plus que pour le travail, le Tout en un, encyclopédie illustrée des connaissances humaines publié par la librairie Hachette, épais volume de près de 1500 pages, qu’elle avait reçu en cadeau de fin de scolarité. Elle achetait régulièrement Télé 7 jours.
Car, en plus de la radio, très écoutée, c’est la télévision – télévision noir et blanc – qui, à partir de novembre 1960, devint centrale pour la famille entière. Nous ne boudions pas notre plaisir aux émissions de chansons et de jeux, mais regardions aussi, tous ensemble, en ces temps reculés où il n’y avait qu’une seule chaine, Le journal d’un curé de campagne de Robert Bresson, un dimanche d’hiver, à 17 heures 15, la version de 1938 du J’accuse d’Abel Gance, un autre dimanche, à 20 heures 30, les dramatiques du mardi soir, Montherlant y compris, et le Théâtre de la Jeunesse de Claude Santelli. Nous regardâmes et écoutèrent en stéréophonie Les Perses, d’Eschyle et Jean Prat, le 31 octobre 1961. J’ai quasiment cessé de regarder la télévision en 1967 quand je suis parti en Tunisie.
Stimulé par une injonction maternelle bienveillante, j’ai gagné, au milieu des années 50, semaine après semaine, en envoyant de beaux dessins au 22 de la rue Bayard, la collection complète de « Au paradis des animaux » écrit et dessiné par Alain Saint-Ogan, gentiment offert par Radio Luxembourg et par La Vache qui rit, célèbre fromage à tartiner.
 J’ai pu lire et relire, grâce aux copains du quartier, la plupart fils et filles de mineurs, les albums déjà parus des « Aventures de Tintin » ; ce sont eux aussi qui m’ont permis de connaitre Bibi Fricotin, Les Pieds Nickelés, Popeye, Tartine Mariol, Pim, Pam et Poum ; mes parents qui ne m’auraient pas autorisé à acheter et à collectionner ces bandes dessinés me les laissaient toutefois lire, assis sur les marches extérieures de l’entrée de la maison.
J’ai pu lire et relire, grâce aux copains du quartier, la plupart fils et filles de mineurs, les albums déjà parus des « Aventures de Tintin » ; ce sont eux aussi qui m’ont permis de connaitre Bibi Fricotin, Les Pieds Nickelés, Popeye, Tartine Mariol, Pim, Pam et Poum ; mes parents qui ne m’auraient pas autorisé à acheter et à collectionner ces bandes dessinés me les laissaient toutefois lire, assis sur les marches extérieures de l’entrée de la maison.
J’ai, une demi-douzaine de fois, bravé l’interdiction familiale, en rapportant de l’école un exemplaire du numéro du mois de Francs-Jeux que mon père et ma mère se voyaient, forts en colère et me punissant quelquefois, contraints de régler à l’instituteur. C’était pourtant là une lecture plus instructive que distrayante, de surcroit peu coûteuse.
Paradoxalement, mon père m’offrit, en cadeau de Noël 1958 et 1959, achetés, je pense, à un militant communiste qu’il avait assuré sur la vie, les albums 8 et 13 du journal Vaillant, lourds recueils lus jusque dans les recoins et dans lesquels j’appréciais particulièrement Les Pionniers de l’espérance de Roger Lecureux et Raymond Poïvet, La pension Radicelle (et son univers improbable) d’Eugène Gire et P’tit Joc de Jean Ollivier et André Joy (à cause du personnage de Luce, adolescente diaphane). Je n’ai jamais acheté Vaillant en maison de la presse, mais en possède aujourd’hui la collection quasi complète.
J’ai acheté, pendant quelques mois, avant mes douze ans, parce que nous jouions beaucoup aux cow boys et aux indiens dans les voyettes du numéro 5 de Bruay-en-Artois, Kit Carson, en petit format – les copains ne jurant, eux, que par Hopalong Cassidy dont les aventures étaient diffusées en feuilleton dans Le club du jeudi de la télévision.
J’ai aussi, à partir du numéro 1147 « Spécial Pâques » du 7 avril 1960, acheté Spirou pendant dix semaines – période Yvan Delporte, la meilleure – que je lisais déjà chez le coiffeur, prétextant un concours qu’organisait le journal. Comme dans Vaillant, la plupart des histoires étaient à suivre et je n’ai connu que très longtemps après la fin de celles-ci. Le concours était difficile et je n’ai pas gagné. Peu après, je changeais de coiffeur.
J’ai lu, en ne négligeant pas tant d’articles que cela, trois « gratuits », comme on dit aujourd’hui, que je trouvais sur la table de la cuisine au retour de l’école : Carrousel, magazine donné à leurs bonnes clientes par les épiciers de l’Union des négociants en alimentation (UNA), Le Journal des coopérateurs de France, autre publication épicière, et La lampe au chapeau, « journal du personnel [des Houillères] du groupe de Bruay ».
L’unique abonnement de cette époque, souscrit en 1960 ou en 1961, ce fut L’avant-scène théâtre – manière de prolonger les dix minutes d’actualités théâtrales proposées chaque dimanche soir, à la télévision, par Lise Elina, Max Favalelli et Paul-Louis Mignon.
J’ai lu Nano et Nanette grâce à de jeunes cousines, les premiers numéros de Pilote, en 1959, grâce à un cousin de même âge et, comme tout ado des années 60, Salut les copains parce que, jeunes lycéens à argent de poche, nous avions tous au moins un copain – justement un copain -, qui, auditeur d’Europe n°1 et non de Radio-Luxembourg, avait, en juillet 1962, acheté le numéro 1 du magazine – numéro qui, dès sa couverture, demandait au lecteur de dire s’il était pour ou contre Vince Taylor et, surtout, l’enjoignait de ne pas oublier Eddy Mitchell ; le prénom du chanteur étant orthographié Eddie, je n’ai pas oublié.
Des titres parmi d’autres
Quelques titres de livres offerts par la famille proche, à l’occasion des fêtes de fin d’année ou d’anniversaires, jusque vers mes quatorze ou quinze ans :
– Goupil, Brun l’ours et Les malheurs d’Ysengrin, édités chez Delagrave avec des illustrations de Samivel ;
– des albums du Père Castor, une demi douzaine, dont Panache l’écureuil de Lida et Apoutsiak, le petit flocon de neige de Paul-Emile Victor ;
– en plus grand nombre, des « Albums roses » et des « Petits livres d’or » dont Monsieur Chien, lu cent fois car c’est quand même un drôle de personnage que ce chien qui vit sa vie, seul, en toute liberté ; confirmation récente par Cécile Boulaire et je viens de lire ce commentaire d’une cliente sur le site d’une librairie en ligne : « Le premier livre qui a fait de moi ce que je suis. J’avais trois ans à l’époque et maintenant je suis grand-mère » ;
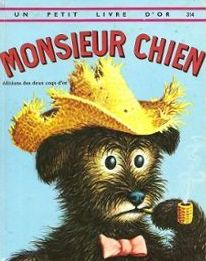 – des « Bibliothèque verte », guère plus de dix, dont L’épave du Cynthia de Jules Verne et André Laurie, très souvent relu, et un très curieux roman, Voyage en dentelles de Jeanne de Recqueville (paru en 1956) qui raconte les aventures de Marie-Laure et de ses sœurs chargées de présenter à Catherine de Russie, à l’aide de poupées mannequins, les robes que l’impératrice a commandées à un couturier français ;
– des « Bibliothèque verte », guère plus de dix, dont L’épave du Cynthia de Jules Verne et André Laurie, très souvent relu, et un très curieux roman, Voyage en dentelles de Jeanne de Recqueville (paru en 1956) qui raconte les aventures de Marie-Laure et de ses sœurs chargées de présenter à Catherine de Russie, à l’aide de poupées mannequins, les robes que l’impératrice a commandées à un couturier français ;
– des ouvrages des éditions Nelson dont Les Misérables qui fut ma première lecture au long cours ; je n’ai sauté aucune ligne et lu intégralement les chapitres consacrés à l’argot, langue de la misère ;
– en vrac, Till Eulenspiegel (Charles de Coster), L’homme à l’oreille cassée (Edmond About), Le monde merveilleux des insectes (Jean-Henri Favre), Les contes d’un buveur de bière (Charles Deulin), recueil actuellement indisponible chez les éditeurs ;
– je ne sais plus dans quelle collection j’ai découvert Sans famille, mais je me souviens qu’un lecteur précédent (auquel mon père avait racheté le livre) avait écrit, au crayon, dans la marge : « On voit bien qu’Hector Malot n’a jamais vécu dans les mines », gribouillis que je ne comprenais pas, car la précision des chapitres racontant le travail des mineurs de Varses, l’inondation des galeries et le sauvetage des ouvriers me convenaient tout à fait. J’ai lu, à la même époque, En famille et j’ai compris, non le paternalisme, mais ce qu’était une aumuche ;
– pas de « Rouge et Or », pas de Bourrelier.
J’ai, bien sûr aussi, un peu plus tard, acheté, de loin en loin, des livres de poche ; je me souviens des images de couvertures de 325 000 francs de Roger Vaillant et de Jean Barois de Roger Martin du Gard.
L’un de mes grands-pères, ancien gendarme, vivait sa retraite à Hérisson, village du nord de l’Allier où il fut un temps chargé de relevés cadastraux ; à cette occasion, il rassembla des mètres cubes de livres et de journaux anciens et moins anciens dans lesquels, des vacances durant, je me suis plongé, plus libre que je ne l’aurais été dans une bibliothèque publique, lieu où je n’ai pas mis les pieds avant ma seizième année.
Il y a avait, en vrac, dans une sorte de soupente :
– des récits complets « Artima », format cahier, histoires en bandes (pas très bien) dessinées de Far West, de jungle, d’espaces inter-galactiques et autres mauvais genres où les méchants pullulent ;
– des romans, populaires ou non, découpés en fascicules ; c’est dans cette présentation sommaire que j’ai lu mes premiers Zola dont une Faute de l’abbé Mouret, en trois « volumes à 2 francs », qui me fit forte impression ;
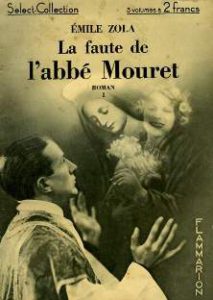 – des romans divers tels que Ces dames au chapeau vert, de Germaine Acremant, dont je n’ai su que plus tard que l’histoire se déroule à Saint-Omer ;
– des romans divers tels que Ces dames au chapeau vert, de Germaine Acremant, dont je n’ai su que plus tard que l’histoire se déroule à Saint-Omer ;
– des collections reliées, vraisemblablement reçues d’un notaire, des Annales politiques et littéraires d’Adolphe Brisson et d’une autre publication où je découvris le feuilleton théâtral de Francisque Sarcey.
Premier bénévolat
Je n’ai pas été louveteau, éclaireur ou pionnier et je n’ai jamais eu à faire de bonnes actions (bénévoles) obligatoires.
S’il fallait dater le moment du premier caillou, ce serait vers ma dix-huitième année et le domaine est d’emblée culturel. Je suis à L’École normale, externe parce qu’habitant Orléans. L’établissement dispose d’un ciné-club dont personne ne veut s’occuper. Je me propose avec un autre externe. Et c’est ainsi que pendant une année, tout reposa, bénévolement, sur nous deux : choix des films – on nous reprocha longtemps d’avoir osé programmer Antonioni, L’avventura ou La notte, je ne sais plus -, publicité interne à l’établissement, acheminement des bobines de la gare jusqu’au 110 faubourg de Bourgogne le matin de la séance, encaissement des entrées, projection, retour des bobines à la gare le lendemain matin. Tout cela pour une grosse poignée de spectateurs.
(André Delobel – septembre 2014)
André Delobel est secrétaire de la section de l’Orléanais du CRILJ depuis plus de quarante ans et secrétaire général au plan national depuis 2009 ; co-auteur avec Emmanuel Virton de Travailler avec des écrivains (Hachette, 1995), au comité de rédaction de la revue Griffon jusqu’à ce que la publication disparaisse fin 2013, il assura, pendant quatorze ans, la continuité de la rubrique hebdomadaire « Lire à belles dents » publiée dans le quotidien du Loiret La République du Centre ; articles récents : « Promouvoir la littérature de jeunesse : les petits cailloux blancs du bénévolat » dans le numéro 36 des Cahiers Robinson (2014) et « Les cheminements d’Ernesto » dans le numéro 6 des Cahiers du CRILJ consacré au théâtre jeune public (2014) ; contribution au catalogue Dans les coulisses de l’album : 50 ans d’illustration pour la jeunesse, 1965-2015 (CRILJ, 2015).