Dès 1944, les premiers textes fondateurs du Grand Mouvement (première appellation du Mouvement des Francs et Franches Camarades puis des Francas) prévoyaient de publier un hebdomadaire à gros tirage s’adressant aux jeunes de huit à 14 ans. Les aléas du démarrage repousseront ce projet de quelques années puisque c’est en 1953 que paraît Jeunes Années, sous-titré « L’almanach de l’écolier et de l’écolière », magazine dont Alain Fourment dans son ouvrage Histoire de la presse des jeunes et des journaux pour enfants dit qu’il a contribué à faire naître une nouvelle conception du journal pour enfants.
Sous différentes formes, seuls ou en partenariat, nous avons donc agi à la fois dans le domaine de l’édition et dans celui de l’information. Cela a été le cas avec la brochure Une année de lecture produite par Jacqueline et Raoul Dubois qui faisait une présentation critique de la production annuelle des livres pour la jeunesse ou encore avec un accompagnement à la mise en place de la base de données Livrjeun créée par le CRILJ des Yvelines (Roger Boquié et Monique Bermond) avec le soutien de l’Association Française pour la Lecture. Le relais a été pris aujourd’hui par l’association Nantes Livres Jeunes.
Nous continuons aujourd’hui à proposer différentes opérations d’animation au niveau de notre Fédération mais surtout dans les départements et au plan local : mise en place de malles lecture, de station-livres, rencontres inter-centres, etc. Cela se complète par la mise en place des séquences de formation dans ce domaine dans le cadre du BAFA ou de formations destinées à des professionnels.
« L’éducation doit être harmonieuse, c’est-à-dire faire appel à toutes les techniques, tous les arts, toutes les formes d’expression qui permettent à chacun l’accomplissement de la personnalité et l’insertion volontaire dans une collectivité humaine » écrivions-nous dès 1969.
Ainsi, quelle que soit la forme d’intervention retenue nous agissons avec cette volonté, maintes fois réaffirmée, de valoriser l’importance de l’écrit et de considérer presse et littérature de jeunesse comme des composantes essentielles de l’activité éducative et culturelle en direction des enfants et des jeunes.
Enfin nous agissons en prenant en compte deux orientations complémentaires et indissociables : avoir une action pédagogique en direction des individus, avoir une action à la fois pédagogique et politique sur notre environnement.
Le premier type d’action doit permettre à chacun d’acquérir puis d’entretenir des compétences de lecteur et donner à l’enfant l’envie et le besoin d’avoir en permanence recours à l’écrit pour créer et entretenir des projets de lecture ou d’écriture.
L’action sur l’environnement doit être pédagogique au sens où elle doit permettre que tous ceux qui accompagnent l’enfant dans l’apprentissage de la lecture, dans le développement du goût de lire, puissent partager les enjeux de l’action pédagogique en direction des enfants. Cela suppose une certaine complémentarité mais cela exige surtout une cohérence, s’informer et s’expliquer sur le rôle des uns et des autres.
Si l’on considère que la lecture est l’affaire de tous (la famille, l’école, le temps libre), cette action est aussi politique au sens où elle doit, sur un territoire donné, concerner l’ensemble des temps de vie de l’enfant et les différentes personnes ou institutions qui participent à son accueil. Ainsi, il ne suffit pas de parler, de manière générale, d’une politique de la lecture. Il faut, à l’échelle d’un quartier, d’une ville, d’une communauté de communes, pouvoir observer les besoins des publics puis recenser et mettre en synergie les moyens disponibles pour développer la relation à l’écrit. Cela suppose complémentarité et cohérence des actions pédagogiques mais aussi développement de accessibilité à l’écrit : accessibilité économique certes, mais aussi physique (comment répondre aux besoins au plus près des publics), informative (faire connaître les différentes possibilités d’accès à l’écrit sur un territoire donné) et socioculturelle (faire comprendre que l’écrit est à la portée de tous).
L’ECRIT DANS LES ACTIVITES DE LOISIRS
1) Quels écrits ?
D’abord il nous semble important de mettre en avant la place de l’écrit – et donc à la fois de la lecture et de l’écriture – pour ne pas réduire l’action dans ce domaine à la seule promotion de la littérature de jeunesse, plus particulièrement du livre, même s’il s’agit d’une action indispensable. La presse en particulier, la bande dessinée, Internet aujourd’hui, ont aussi toute leur place dans les activités à proposer dans les temps de loisirs.
Au-delà de l’utilisation de cette production, particulièrement riche et diversifiée, il est essentiel aussi de s’appuyer sur ce qu’on peut appeler les « écrits du quotidien » qu’il s’agisse de ceux que l’on rencontre dans la structure d’accueil (le programme d’activités, le règlement du centre, les menus, la lettre des correspondants) ou dans son environnement proche : qu’est-ce qu’on peut lire dans la rue, à la devanture des magasins, etc.
2) Découvrir l’écrit, pourquoi ?
Proposer aux enfants et aux adolescents d’aller à la découverte de l’écrit c’est à la fois :
– agir dans le domaine de la médiation pour donner envie de découvrir et d’utiliser cette composante de leur environnement ;
– s’appuyer sur les apprentissages scolaires et les conforter : développer les capacités de lecture, les comportements de lecteur ;
– donner les outils permettant à chacun d’exercer son sens critique et d’être en capacité de choisir ou les outils permettant de s’informer, de communiquer et de produire soit même de nouveaux écrits.
3) S’appuyer sur les spécificités des temps de loisirs
Une action dans les temps de loisirs, péri ou extrascolaires permet aux enfants de s’approprier des savoirs en les investissant volontairement dans un autre contexte que celui de l’apprentissage, à leur propre rythme, dans des situations diverses.
Elle constitue un espace où ils peuvent découvrir des situations, réaliser des expériences hors du cadre familial ou scolaire, avec des adultes qui n’ont ni l’autorité parentale, ni l’autorité professorale. C’est un espace de choix, de réalisation collective de projets avec ses pairs, d’échanges de savoirs.
Les activités de loisirs ont l’intérêt de n’être pas contraintes par des programmes ou par des exigences de résultats autres que celles que le groupe se donne. Elles développent qualitativement les savoir-faire, les savoir être, et concourent à l’enrichissement des connaissances.
Ainsi ces activités, dans leur diversité, favorisent les apprentissages scolaires, les complètent, les valorisent, parfois les suscitent. En complément des activités du temps scolaire, elles constituent une source d’enrichissement personnel, de formation individuelle sociale et culturelle. Elles offrent également aux enfants et aux adolescents des espaces de participation, dans lesquels une large place est laissée à l’initiative et à la spontanéité. Elles tiennent un rôle majeur dans l’acquisition des compétences sociales.
Enfin, compte tenu des conséquences de l’évolution des temps sociaux sur le temps de vie des parents, compte tenu aussi de l’augmentation des situations de pauvreté et de précarité cette action contribue à la réduction des inégalités d’accès à l’offre éducative.
4) Une approche pédagogique
Quatre niveaux d’intervention peuvent être retenus, même s’il ne s’agit pas de passer par quatre étapes successives mais de penser, dans le déroulement des activités, à faire acquérir les repères qui permettront de construire et d’enrichir différents projets.
. Sensibiliser à la diversité des écrits
Il s’agit de « mettre en appétit », de développer la curiosité. En référence à la production actuelle on peut faire découvrir, de manière ludique chaque fois que c’est possible, différents types de supports (album, roman, documentaire, BD ou encore presse jeunesse, presse d’information, presse spécialisée, et aussi dictionnaire ou fiches d’activités. Le lecteur peut observer les différentes formes utilisées (histoires, documents, jeux, illustrations) et ce qui les distingue : présentation, format, pagination, prix, place de l’illustration, périodicité, qualité du papier, place de la publicité. De la même façon, en référence aux écrits du quotidien, on peut s’appuyer sur la vie du groupe, de la structure pour découvrir différents types d’écrits et la forme utilisée : affiches, courrier, panneaux de signalisation, publicités.
. Découvrir les caractéristiques des différents supports ou des différents écrits
Pour percevoir ces caractéristiques et, éventuellement, faire évoluer l’idée ou la représentation que chacun peut se faire du livre, de la presse, il s’agit de comprendre :
– « de quoi ça parle » : de l’actualité, du passé, de l’histoire des hommes, de la situation des enfants, des techniques,
– « à quoi ça sert » : pour la lecture plaisir, pour s’informer ou se documenter, pour réaliser une activité, pour jouer, pour échanger,
– « comment ça fonctionne » : le sommaire, la table des matières, la une, les rubriques.
. Apprendre à les utiliser
Il s’agit de mettre en valeur les différentes façons d’utiliser les écrits en s’appuyant, c’est essentiel, sur la construction de projets de lecture ou d’écriture individuels ou collectifs. Il s’agit de montrer que certaines réponses peuvent se trouver dans l’écrit. Comment utiliser des livres, des journaux ou magazines, Internet, le dictionnaire, le programme TV, un guide touristique, dans différents projets : rédiger un exposé, rechercher une documentation, préparer une sortie, etc.
Ces projets peuvent en effet naître d’une sollicitation de l’environnement (la journée des droits de l’enfant, la semaine du goût, un événement sportif, des élections, une catastrophe climatique), de la vie du groupe (préparer un dossier pour les correspondants, rechercher des recettes pour un goûter d’anniversaire).
. Mettre en situation de produire des écrits
On peut s’appuyer soit :
– sur les contenus découverts : inventer une autre fin de l’histoire, monter un spectacle de marionnettes, réaliser une revue de presse,
– sur les caractéristiques de tel ou tel support : inventer un conte, créer une bande dessinée, un roman-photo, produire un journal d’information.
5) Des conditions à réunir
. Au plan général
Il convient à la fois de bien connaître :
– le public auquel on s’adresse qui souvent se caractérise par son hétérogénéité. Qui est-il ? Quelles sont ses pratiques de lecture ? Quels sont ses besoins, ses attentes ? Pour cela on peut mettre en place un questionnement dans la structure d’accueil et/ou s’appuyer sur d’autres partenaires (la bibliothèque ou la médiathèque, les établissements scolaires),
– les potentialités de l’environnement dans le domaine concerné (journal local ou régional, radio, centres de documentation des établissements) ou au plan de la politique enfance/jeunesse. Existe-t-il un projet éducatif local donc des orientations éducatives, un diagnostic, des directions d’action ? Y a-t-il des possibilités de partenariat avec des services municipaux, des établissements scolaires, des associations de parents.
. Au plan pédagogique
… Développer des activités adaptées au public visé :
Les activités proposées doivent :
– privilégier le jeu. En effet, compte tenu des conditions d’apprentissage, certains enfants ne considèrent l’écriture ou la lecture que comme des activités scolaires. Il est alors intéressant de les « réconcilier » avec ces activités en utilisant des situations de jeu,
– s’appuyer sur les motivations des enfants et des jeunes en sachant utiliser les écrits du quotidien, ceux qui sont en rapport direct avec les préoccupations de la vie et leurs projets d’action,
– les mettre « en appétit de lecture » (donner l’envie de mettre en œuvre des projets de découverte et d’utilisation de l’écrit pour que, progressivement les utilisateurs acquièrent une autonomie dans ce domaine),
– leur permettre de maîtriser les techniques d’utilisation des différents écrits ou supports.
Il faut aussi penser à valoriser les activités réalisées vis-à-vis des adultes (les parents, les enseignants, la municipalité) et des autres enfants ou jeunes.
… Agir dans le domaine de la formation :
Une formation théorique des animateurs doit permettre de sensibiliser à la production, d’apprendre à l’utiliser, d’apprendre à utiliser l’écrit dans la vie du groupe (et donc dans le cadre d’un stage).
Mais elle doit se compléter par une formation sur le terrain pour apprendre à situer son action dans un cadre plus global, à travailler avec d’autres partenaires (collège, médiathèque, journal local), à utiliser les préoccupations motivations des jeunes (ils s’intéressent à la coupe du monde de foot : on peut écrire des reportages, faire un album souvenir, organiser une journée portes ouvertes à la médiathèque pour découvrir des documents).
. Au plan matériel
Il faut pouvoir en permanence mettre à la disposition des enfants et des jeunes différents supports, différents écrits. Cela doit permettre de les découvrir, d’apprendre à les utiliser et d’y avoir recours dans un certain nombre d’activités.
L’idéal est d’installer un « coin-lecture » dont l’aménagement devra être conçu en fonction :
– des activités que l’on veut pratiquer dans cet espace : lire, écrire, rechercher des documents, produire, échanger,
– des comportements que l’on veut induire : favoriser l’appropriation des supports, responsabiliser, faire participer au choix, permettre de s’isoler, donner envie de,
– de l’atmosphère que l’on veut créer : calme, chaleureuse, studieuse.
L’animation de l’espace doit à la fois permettre :
– d’apprendre à respecter le matériel mis à disposition et à responsabiliser les utilisateurs,
– de s’approprier les règles de fonctionnement de l’espace (prêt ou consultation sur place), le repérage des différents supports (classement, codification), les règles de fonctionnement des différentes propositions (CD, vidéo, Internet),
– de prévoir différents types d’utilisation, individuelle ou collective,
– de faire participer les enfants ou les jeunes à cette animation : présenter de nouveaux supports, rédiger la fiche d’identité d’un nouveau magazine, prendre en charge le prêt,
– de mettre en valeur les supports présentés,
– de mettre en valeur les réalisations produites.
LA PRESSE POUR LA JEUNESSE
Née véritablement au 19e siècle, la presse des jeunes a su, à chaque époque, innover et accompagner avec un succès grandissant le public des enfants et des adolescents.
L’actualisation permanente des différentes formules de presse et la créativité des équipes de rédaction ont permis de constituer dans notre pays une presse sans équivalent au monde, qu’il s’agisse du nombre de titres ou de nouveautés présentés chaque année.
Trois caractéristiques essentielles peuvent être mises en avant lorsqu’on observe la production actuelle :
– sa diversité : plus de 100 titres destinés aux 9 mois/20 ans avec une diffusion annuelle de 150 millions d’exemplaires (plus de deux enfants sur trois lisent régulièrement un titre de la presse jeunesse). Presse distractive et éducative, presse d’activités, presse féminine, presse d’actualité, presse lecture, presse de jeux, toutes ces formes de presse constituent une alternative aux jeux vidéo et à la télévision.
– sa force créative : elle produit chaque année plus de 50 000 pages de création inédites, texte et images.
– La renommée des écoles françaises d’illustrateurs a fait le tour du monde et la presse jeunesse constitue souvent un tremplin pour les nouveaux talents, comme elle a su accueillir, depuis de nombreuses années, des créateurs de tous les pays.
– sa proximité avec les lecteurs : forte d’une communication en profondeur auprès d’eux et d’une relation sur la durée, la presse jeunesse est le seul média pouvant revendiquer d’être « le copain de papier ».
– Le magazine, de plain-pied avec l’univers de tous les jours, est pour les enfants un espace de choix et de liberté, situé du côté des préoccupations et des centres d’intérêt de ses lecteurs. Il leur apprend à sélectionner, à choisir, pour accéder à l’information dont ils ont besoin.
Quelle utilisation dans les loisirs des jeunes ?
On peut s’interroger sur l’intérêt qu’il peut y avoir à utiliser la presse et en particulier la presse des jeunes dans des activités de loisir avec des enfants et des adolescents. Est-ce que cela les intéresse toujours ? Est-ce qu’ils ne préfèrent pas aujourd’hui d’autres médias ? Est-ce que cela n’apparaît pas comme une nouvelle activité scolaire ? Autrement dit : à quoi ça sert ? Est-ce que c’est un support éducatif ? Est-ce qu’ils ont besoin d’adultes pour la découvrir ?
Des éléments de réponse
La presse, dans sa diversité (journaux enfants et jeunes, mais aussi presse quotidienne régionale, journaux sportifs, magazines de mode, programmes télé) font partie de l’environnement quotidien de l’enfant et du jeune.
Si l’on considère que les activités que nous proposons doivent permettre à chaque enfant de découvrir et de comprendre cet environnement, alors il faut donner des occasions de découvrir la presse, de l’utiliser et sans doute aussi d’en produire.
Pourquoi utiliser la presse ?
La presse répond au besoin et à la nécessité d’information, en référence à la Convention internationale des droits de l’enfant (droit de recevoir, de rechercher, de produire des informations), à l’importance de la fonction information dans le fonctionnement démocratique des collectifs enfants/jeunes. Elle prépare ainsi les lecteurs et les citoyens de demain.
Elle est un outil de découverte, de connaissance. Elle permet de mettre « en appétit de lecture » grâce aux différentes entrées qu’elle propose et elle développe ainsi la capacité de l’enfant à construire des projets de découverte par la lecture.
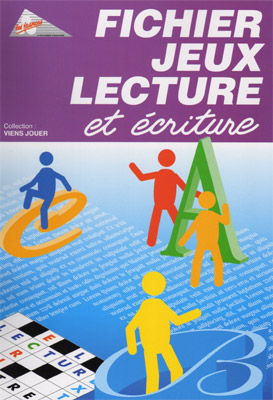
Enseignant désormais retraité, Francis Vernhes est mis à disposition de la Fédération nationale des Francas de 1965 à 1995 et en devient, en 1996, vice-président. Nombreuses opérations d’animation, d’information et de formation dans le domaine du livre et de la lecture. Directeur des éditions Jeunes Années de 1985 à 1996, Secrétaire général puis président du Syndicat de la presse des jeunes jusqu’en 1997 et chargé de mission de ce syndicat jusqu’en 2009, Francis Vernhes fut, pendant 15 ans, membre de la Commission de surveillance des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence. Il est coordinateur de l’ouvrage collectif Lire à loisir, loisir de lire (INJEP, 1987) et du fichier d’activités Jeux de lecture et d’écriture (Francas). Merci à lui pour nous avoir confié ce texte.





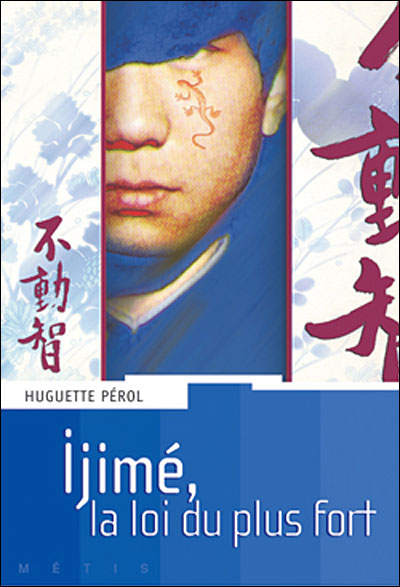


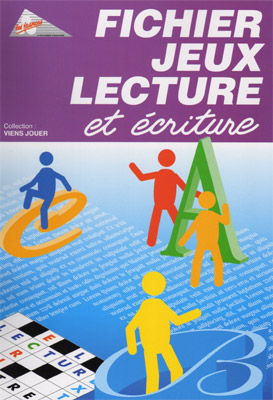
![mirent101[1]](http://www.crilj.org/wp/wp-content/uploads/2011/09/mirent1011.jpg)