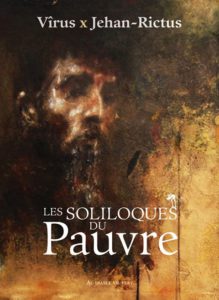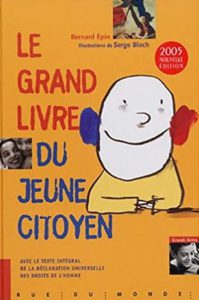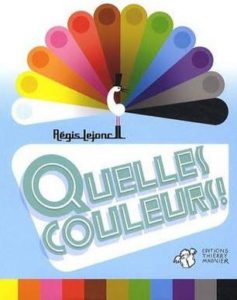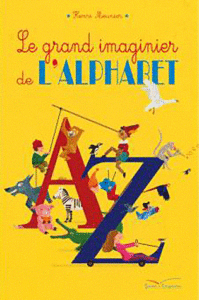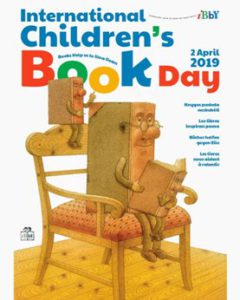C’était il y a presque trois années. Le mardi 26 janvier 2016, le CRILJ/Midi-Pyrénées découvrait la toute jeune médiathèque d’Auterive. Ce fut l’occasion d’une rencontre avec Régis Lejonc et Henri Meunier organisée en connivence avec l’établisement. Occasion de « voyager sur ces fabuleux tapis volants que sont les livres pour enfants », comme aime à le dire Régis Lejonc. Deuxième partie d’un fort détaillé compte-rendu.
Ghislaine Roman – Quand on est soi-même illustrateur, comment se passe la collaboration avec un autre illustrateur ? Quelles limites ne vous autorisez-vous pas à franchir ?
Henri Meunier : Je ne crois pas être trop intrusif. Si je pense à celui ou à celle qui pourra illustrer mon texte, c’est que je sais qu’il ou elle pourra apporter par l’image tout ce que je veux taire ou tout ce que je n’ai pas su dire. Je n’aime pas être trop bavard et je pense que c’est important de pouvoir compter sur les qualités de l’auteur ou de l’illustrateur avec qui on collabore.
Régis Lejonc – Moi je suis auteur de manière très occasionnelle. J’écris des textes quand ça me traverse, quand ça me foudroie. Et le premier que j’ai écrit, Les deux géants, je l’ai illustré moi-même. Pour le texte de Au bout du compte, j’étais en train de travailler à l’ordinateur sur une image et une phrase me tournait sans cesse dans la tête : « Un jour, j’ai trouvé un arbre ». Donc, j’ai ouvert une page et j’ai tapé la phrase. A partir de là, le texte m’est venu et je l’ai écrit en dix minutes sans rien y changer. Ce qui me laisse à penser que ce texte était en moi depuis assez longtemps. C’est une espèce de poème et j’ai pensé à Martin Jarrie pour l’illustrer. Il fallait des sortes d’images mentales, des choses un peu étranges, un peu abstraites, tout à fait dans son style. L’illustrer de façon narrative n’aurait eu aucun sens. J’ai vécu ça aussi avec Carole Chaix sur Un an et un jour, un texte pas évident au départ et qui, fort de son illustration, devient une sorte de colonne vertébrale. Ce sont des livres un peu comme des murs d’escalade, sans prises toute faites que chacun monterait à sa façon. Je les vois comme ça, ces livres-là, un peu vertigineux, inhabituels pour certains lecteurs adultes, alors que les enfants ne se posent pas ces questions.
 G.R – Henri, c’est à ton tour de tirer. Case A3 : Le projet Grateloup. Une expérience qui a abouti à un objet livre. Henri, est-ce que tu peux raconter ?
G.R – Henri, c’est à ton tour de tirer. Case A3 : Le projet Grateloup. Une expérience qui a abouti à un objet livre. Henri, est-ce que tu peux raconter ?
H.M – On a eu la chance d’être invités plusieurs fois à ce salon. Et puis un jour, lors d’un repas avec les copains de l’association Mange-Livres qui l’organisent, on discute de leur volonté de redynamiser le projet car ils commençaient à s’essouffler un peu. Et Alfred a lancé comme une boutade : « C’est pas compliqué, vous nous laissez une semaine nourris-logés et on vous fait un livre ! » Ils nous ont pris au mot ! Ils ont accepté cette expérience : réunir six auteurs dans un lieu, une semaine. Quelque temps après, on est tous arrivés avec notre caisse de matériel et, après le repas de bienvenue, on s’est mis à travailler sur le thème choisi : le loup. On a heureusement bénéficié de la clairvoyance de Claire Franek pour l’organisation du travail deux par deux, pour les enchaînements, etc. Je me suis retrouvé avec Carole Chaix pour plancher sur la première page. Moi je suis assez cartésien, j’aime bien que toutes les choses soient pesées avant d’être posées sur le papier. Alors que Carole est foutraque et comprend les choses après les avoir faites. Mais, il n’y avait pas à tortiller, chaque soir, nous devions avoir terminé notre page. Ce fut une belle aventure humaine. On s’était donné comme objectif d’en profiter pour se faire essayer réciproquement nos outils, pour tenter des trucs qu’on ne connaissait pas, pour inviter les autres dans nos jardins secrets. Et on a bien réussi à faire !
R.L : Et nous avons donc, tous, fait un livre en six jours !
G.R : Allez hop ! Régis, tu tires.
R.L : Ce sera C4. Et, dans cette case, c’est Henri auteur et Henri illustrateur…
(lecture de l’album L’autre fois)
G.R – Nous allons revenir sur l’interview que tu nous as accordée lorsque nous avons fait notre brochure sur les albums poétiques. Tu nous avais dit : « Quand j’écris mon texte, j’en fais une première version que je vais retravailler indéfiniment. Parmi les choses qui me poussent à ce travail, il y a une exigence de justesse dans le sens qui fait que je suis amené parfois à utiliser des mots qui sont un peu compliqués pour les enfants, mais ce sont les mots justes par rapport aux sentiments, à l’émotion, à la description que je suis en train de donner. » Évidemment, ce qui nous tarabuste là-dedans, c’est « indéfiniment » ! Où est le curseur ? Ça va d’où à où ce travail ?
H.M – Je ne sais pas. Le plus long compagnonnage avec un texte avant d’en être content c’est avec celui de La rue qui ne se traverse pas que j’ai ré-écrit, observé, soupesé pendant une dizaine d’années jusqu’à ce que je trouve la dernière phrase, celle qui lui a permis de prendre tout son sens, son sens profond; ça peut prendre du temps, mais je ne suis pas pressé. Comme dit Régis, j’ai la chance de pouvoir convoquer des histoires quand j’en ai envie. Et puis j’ai un ordinateur rempli d’histoires ! Mon problème, ce n’est pas qu’elle soit finie demain ou dans quinze ans, c’est qu’elle soit bien, c’est qu’il n’y ait pas un mot que je puisse bouger. Ce qui est aussi faux, car dans les bouquins que j’ai écrit il y a dix ans, je pourrais bouger les mots. Mais il y a quand même un moment où je me dis, c’est bon, c’est ce que je voulais pour ce texte.
 G.R – Tu nous lis la dernière phrase, celle qui te manquait ?
G.R – Tu nous lis la dernière phrase, celle qui te manquait ?
H.M – J’en étais resté à « Homme ou moineau l’équilibre est le même. L’essentiel est de savoir s’appuyer sur le vide. » Mais il manquait quelque chose d’essentiel là, c’est à dire ces huit mots, la dernière phrase : « Le vacarme d’une vie est un battement d’ailes. »
G.R – Tu nous avais parlé aussi du rapport entre faire son et faire sens. Quand tu parles d’un ogre, tu veux qu’on l’imagine en train de mâcher à travers les sonorités que tu emploies. Est-ce que tu peux développer un peu ?
H.M – Je peux essayer, mais c’est très subjectif et affectif ça. J’ai peut-être une chance dans ma vie d’auteur qui était une malchance dans ma vie scolaire. J’ai été un enfant dyslexique et je reste un adulte dysorthographique. L’orthographe n’a pas grande importance pour moi. Quand je lis, je ne lis pas des lettres qui s’enchaînent, je lis des sons et ces sons font sens. Les mots font de la musique dans ma tête et je m’appuie beaucoup là-dessus quand j’écris. Je fais venir les mots, je les dis, je les fais sonner jusqu’à ce que ça coule si je parle d’eau et que ça siffle si je parle de vent …
G.R – Et ça fonctionne, c’est clair ! Pour beaucoup d’entre nous qui sommes des médiateurs du livre, pour ceux qui lisent à haute voix des textes aux enfants, c’est évidemment un aspect essentiel. Il est clair que les enfants sont sensibles à la musicalité des textes, c’est de l’ordre du sensoriel. Revenons au tableau. Case A2 : Régis Lejonc auteur et illustrateur. « Quelles couleurs ! » est donc, Régis, un livre que tu as fait tout seul. Il a été mis en avant au Salon de Saint-Orens qui avait pour thème le même titre. Tu y as donné une conférence, mais nous sommes nombreux à ne pas avoir pu y assister. Peux-tu nous en parler ?
R.L – Ce livre est un imagier né du croisement des questions que me posent les enfants durant les rencontres scolaires et d’une demande de l’éditrice Valérie Cussaguet. Entre la sollicitation et la sortie du livre, il s’est passé quatre ou cinq ans. L’organisation du livre et l’angle que j’ai choisi se sont imposés de manière évidente car je ne suis pas spécialiste en la matière. Les couleurs ont une histoire liée à l’histoire de l’humanité, elles sont reliées à des rites et à des symboles culturels forts. Je me suis appuyé là-dessus pour construire ma façon de voir les couleurs. Normalement les couleurs se divisent en sept familles : trois couleurs primaires (jaune, cyan, magenta), trois couleurs complémentaires (vert, violet, orange). Et le noir. Le blanc, lui, n’est pas considéré comme une couleur. Moi j’ai voulu avoir un spectre un peu plus large, j’ai donc ajouté aux précédentes : blanc, rose, brun, ocre et gris. Soit douze familles de couleurs. Pendant les quatre années de préparation, j’avais toujours un carnet sur moi, je notais, je listais. J’ai rempli mes carnets d’idées, d’expressions, de références à des chansons, à des textes, à des films, à la culture populaire, à des choses liées à des souvenirs. Tout ça avant de réaliser les images. Et puis, pendant cette période, j’ai fait pas mal de voyages qui ont alimenté aussi et j’ai pris beaucoup de photos en rapport avec mon thème. Enfin, un jour, l’éditrice m’a fixé une date pour la fabrication du livre et il a fallu plonger. Heureusement, à l’atelier, je pouvais tester immédiatement mes trouvailles auprès des copains, pour les dessins, les collages, les photos, les associations d’idées, les mises en page que je travaillais à l’ordinateur.
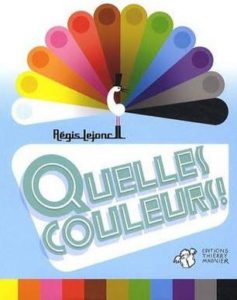 G.R – C’est un très beau travail. Maintenant, Henri, à toi de tirer. Case C5 et c’est : toi auteur, illustré par d’autres. Parlons de ta collaboration avec Nathalie Choux dans « Trop super », la série de BD pour les petits. C’est très intéressant cette articulation entre faits scientifiques et valeurs. Au départ, on se dit « Ah, c’est rigolo ! On revisite les super-héros ! Et puis, on s’aperçoit qu’il y a bien plus que ça…
G.R – C’est un très beau travail. Maintenant, Henri, à toi de tirer. Case C5 et c’est : toi auteur, illustré par d’autres. Parlons de ta collaboration avec Nathalie Choux dans « Trop super », la série de BD pour les petits. C’est très intéressant cette articulation entre faits scientifiques et valeurs. Au départ, on se dit « Ah, c’est rigolo ! On revisite les super-héros ! Et puis, on s’aperçoit qu’il y a bien plus que ça…
H.M – C’est vrai. En fait, moi, quand je lis une histoire drôle et qu’elle n’est que drôle, je m’ennuie. Quand je lis une histoire sérieuse et qu’il n’y a pas à un moment, un poil d’émotion et une pignolade, je trouve que c’est désespérant. J’aime écrire des histoires où on peut passer du doux à l’amer et si, en plus, je peux transmettre quelque chose qui aide à se tenir droit dans la vie… Il ne faut pas négliger non plus l’apport de mes personnages. Parmi eux, il y a une petite tortue qui me ressemble un peu, qui est assez sensible, qui n’est pas superhéros mais qui a un vrai sens de la justice. Si il faut mettre un coup de pied à l’ours qui embête les plus petits, elle va le faire et puis après, elle part en courant. J’étais comme ça quand j’avais 10 ans ! C’est souvent la tortue qui a des réflexions plus sensibles dans l’histoire. Mais c’est pas parce que je l’ai réfléchi, c’est parce qu’elle est comme ça ! Tu sais ça, toi, Ghislaine. Nos personnages existent. C’est nous qui, bien sûr, avons créé ce personnage, mais on ne peut pas lui faire faire n’importe quoi. Il a un caractère, il a une façon de parler, une façon de se comporter.
G.R – Maintenant, pouvez-vous nous dire quelque chose tous les deux sur votre travail en BD. Sur le tien, Henri, avec Richard Guérineau et toi, Régis, sur cette aventure qu’est Kodhja.
 H.M – Pour moi, c’est typiquement un projet d’atelier. A force de partager un lieu de vie, on s’est aperçu qu’on avait un substrat commun : c’était le western du mercredi ! Dans notre enfance, ni Richard ni moi n’avions la télé à la maison et on allait tous les mercredis chez les voisins pour voir le western ! On en a des souvenirs extrêmement forts et l’envie nous est venue de faire ensemble un western BD. J’ai eu l’idée du scénario de départ : une partie d’échecs, deux joueurs avec des pistolets dont l’un serait un gamin bluffeur et, face à lui, l’autre qui commencerait à douter de lui-même. Richard a pensé à la nécessité d’une présence féminine, un rôle pivot entre les deux hommes. En bavardant, on a posé nos personnages, leur personnalité et à partir de là, j’ai écrit.
H.M – Pour moi, c’est typiquement un projet d’atelier. A force de partager un lieu de vie, on s’est aperçu qu’on avait un substrat commun : c’était le western du mercredi ! Dans notre enfance, ni Richard ni moi n’avions la télé à la maison et on allait tous les mercredis chez les voisins pour voir le western ! On en a des souvenirs extrêmement forts et l’envie nous est venue de faire ensemble un western BD. J’ai eu l’idée du scénario de départ : une partie d’échecs, deux joueurs avec des pistolets dont l’un serait un gamin bluffeur et, face à lui, l’autre qui commencerait à douter de lui-même. Richard a pensé à la nécessité d’une présence féminine, un rôle pivot entre les deux hommes. En bavardant, on a posé nos personnages, leur personnalité et à partir de là, j’ai écrit.
G.R – Très bien. Et pour Kodhja ?
R.L – J’ai travaillé avec l’auteur Thomas Scotto. C’est quelqu’un que j’ai rencontré sur des salons. On aime bien, réciproquement, ce que nous faisons et, depuis longtemps, on se disait que ce serait bien de faire un livre ensemble. Thomas avait d’abord proposé son texte à Henri.
H.M – Oui et j’avais fait quelques images mais ça ne collait pas. Nous n’étions pas convaincus, ni Thomas, ni moi.
R.L – C’est un texte pas évident du tout, pas classique, très dialogué. Il avait été adapté pour le théâtre, mais je n’ai pas eu l’occasion de le voir jouer. Lorsque je l’ai lu, ça m’a énormément plu. Et très vite, j’ai senti qu’il se découpait très bien en BD. Enfant et adolescent, j’ai été nourri par la BD. Mon goût pour l’image, et ma culture, c’est la BD ! Je n’en ai pas fait beaucoup mais ses codes me sont familiers. Et je voyais, chez mes copains d’atelier, le travail de marathonien que demande un album de BD.
H.M – Un travail de moine copiste…
R.L – Ou de copiste marathonien ! Ce n’est pas trop mon tempérament, alors je ne me suis jamais lancé là-dedans. Mais là, je me retrouve avec un texte qui, de toute évidence, pour moi, peut être travaillé en BD. Donc, j’ai proposé l’idée à Thomas qui en a été ravi, puis à l’éditeur. J’ai fait un découpage, des croquis et tout tombait impeccable. Ensuite, des choses se sont imposées, des changements, des enrichissements. J’ai proposé par exemple qu’un enfant soit le guide du narrateur qui entre dans cette cité nommée Kodhja et que cet enfant porte un masque dès le départ, masque animalier changeant qui représente un peu l’état d’esprit et les émotions de l’enfant, donc un masque qui n’en est pas vraiment un. Ma deuxième suggestion a été d’étoffer les trois personnages qui attendent de rencontrer le roi. Ils n’étaient pas décrits dans le texte de Thomas, j’ai pensé que ça pouvait être la mort, un robot et Cupidon. Quand j’ai eu bien avancé, Thomas est venu passer une journée à l’atelier et je lui ai proposé de mettre le tout à sa sauce. Ensuite, ça n’a pas été évident avec l’éditeur, Thierry Magnier, qui n’est pas spécialisé en bandes dessinées. Il y a eu un moment de panique avant qu’il accepte de nous faire confiance. Finalement, c’est un très beau livre, un peu atypique qui est sorti en octobre 2015. Il a reçu un accueil critique extraordinaire
G.R – Merci à vous deux, même si nous n’avons pas épuisé nos cases et nos questions…
(mis en forme par Martine Cortès, pour le CRILJ – janvier 2016)
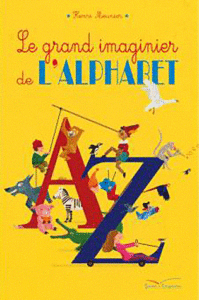
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
. La poupée de Ting-Ting, Ghislaine Roman et Régis Lejonc, Le Seuil, 2015
. L’arbre de paix, Anne Jonas et Régis Lejonc, Flammarion, 2013
. Le grand imagier de l’alphabet, Henri Meunier, Gautier Languereau, 2012
. La rue qui ne se traverse pas, Henri Meunier et Régis Lejonc, Notari, 2011
. Quelles couleurs !, Régis Lejonc, Thierry Magnier, 2009
. Grand et petit, Henri Meunier et Joanna Concejo, Atelier du Poisson Soluble, 2008
. Le phare des sirènes, Rascal et Régis Lejonc, Didier, 2006
. L’autre fois, Henri Meunier, Le Rouergue, 2005
. La mer et lui, Henri Meunier et Régis Lejonc, Notari, 2004
. Ernest, l’enfant qui ne volait pas bien haut, Henri Meunier, Le Rouergue, 2004
. La môme aux oiseaux, Henri Meunier et Régis Lejonc, Le Rouergue, 2003
. Les deux géants, Régis Lejonc, Le Rouergue, 2001
Ghislaine Roman est née dans les Pyrénées, en 1957, dans une petite maison aux volets bleus, au bord d’un torrent de montagne, à une époque où les ours mangeaient tranquillement les myrtilles. Elle a enseigné pendant plus de trente ans, longtemps en maternelle, puis au cours préparatoire. » Ce métier m’a comblée. J’y ai connu des émotions, des découragements, des remises en questions, des bouleversements. […] J’ai travaillé énormément, j’ai lu, réfléchi, mis en œuvre, un peu comme le fait un artisan. Sur une base théorique solide j’ai laissé libre cours à ma fantaisie pédagogique. J’ai adoré cette liberté. Elle a travaillé pour les magazines des éditions Milan Presse (Wakou, Toupie, Picoti, Toboggan). Ses albums illustrés notamment par Tom Schamp, Fredéric Pillot, Olivier Latyk, Clémence Pollet, ont été publiés chez Milan, Cipengo, Saltimbanque, Nathan, P’tit Glénat, Frimousse. La Martinière. La poupée de Ting- Ting, publié au Seuil en 2015, est illustré par Régis Lejonc. Ghislaine Roman fut, dans le département de la Haute-Garonne, chargée du dossier de la prévention de l’illettrisme
p