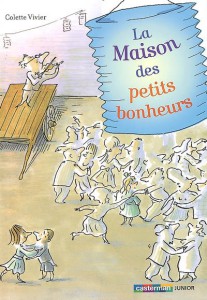Quarante années de discours et de vécus autour de la lecture et de la lecture littéraire et seulement maintenant la découverte d’un court ouvrage Le vice de la lecture publié aux Editions du sonneur dans La petite collection. Ce texte est paru en 1903 dans une revue littéraire américaine. La romancière Edith Wharton (1862 1937) « dénonce l’obligation sociale de la lecture, nuisible à la littérature et fatale à l’écrivain. »
L’auteure nous dresse le portrait du lecteur mécanique qui semble envisager la littérature comme un funiculaire à bord duquel on ne peut embarquer qu’en courant à toutes jambes. A côté se trouve le lecteur-né se promenant avec indolence en diligences et autres chaises de poste, vaguement au fait des nouveaux moyens de locomotion.
Ces trente pages constituent un condensé autour de mots utilisés bien après et qui ont faire causer et écrire : lecture plaisir, lecture devoir, trois positions de lecture : lecteur lisant, lecteur lectant, lecteur lu, le médiateur du pouvoir lire, du vouloir lire et du aimer lire, etc.
C’est ainsi que le lecteur mécanique œuvre systématiquement contre le meilleur de la littérature. A l’évidence, c’est à l’écrivain qu’il est le plus nuisible. La large avenue qui mène à l’approbation du lecteur mécanique est si facile à suivre et si grouillante de compagnons de voyages prospères que plus d’un jeune pèlerin y a été attiré par le seul besoin de camaraderie ; et ce n’est peut-être qu’à la fin du voyage, quand il rejoint le Palais des platitudes et s’assoit devant un festin de louanges sans discernement, avec les plumitifs qu’il a le plus méprisés, se servant sans gêne aucune, du plat préparé en son honneur, que ses pensées se tournent avec envie vers cet autre côté – le droit chemin menant aux « happy few ».

Edith Wharton valorise le lecteur né car il se place dans un processus créatif. L’image des personnages est un mixte entre les données objectives du texte et l’apport subjectif du lecteur, mais chaque récit construit aussi son destinataire et son mode de réception des personnages. Celui qui exprime le désir du texte et celui qui le produit doivent dialoguer. Le lecteur est, le plus souvent, un lecteur virtuel qui va s’incarner. Le texte ne pouvant pas tout décrire laisse des imprécisions, des blancs voulus par l’auteur ou créés par le décalage entre l’univers fictionnel et la réalité. Le lecteur pallie l’incomplétude du texte et réalise une re-création. L’interaction texte-lecteur fait de la lecture un vécu qui s’organise autour des personnages, avec des effets de persuasion, de séduction, de tentation. C’est l’imitation de personnages reçus comme exemplaires qui fait de la lecture un vécu. Mais à l’origine il y a le désir, car lire est d’abord une promesse de plaisir. La jouissance comme fait est incontournable et c’est elle qui fonde et autorise l’aventure du sujet.
Lire n’est pas une vertu. mais bien lire est un art. Edith Wharton insiste sur un lien indestructible entre le roman et le personnage ; qui attente au second ne peut que porter atteinte au premier. La carharsis ne peut se passer du personnage. C’est une énigme, et c’est un fait : nous avons besoin de projection, de tranfert, d’identification. Pour que la fiction opère, nous avons besoin de croire à l’existence d’un personnage en qui se résument et ce concentrent les actions qu’organise la fable. C’est pour cela que le lecteur-né en lisant, se livre, s’oublie ; se compare ; s’absorbe, s’absout. Sur le modèle et à l’image du personnage, il devient autre.
Le lecteur mécanique demande plutôt une littérature prémâchée, a une incapacité à distinguer les moyens de la fin, fourvoie la critique, produit une créature à son image, le critique mécanique. Le lecteur-né peut souhaiter ou ne pas souhaiter entendre ce que les critiques ont à dire d’un livre ; mais s’il se préoccupe de critique, il n’en attend qu’une digne de ce nom-une analyse de sujet et de style. Edith Wharton insiste sur le fait qu’à côté des péripéties, il y a le maniement du sujet et le choix des moyens employés pour produire tel ou tel effet.
Les plus grands livres jamais écrits valent pour chaque lecture par ce qu’il peut en retirer. Les meilleurs livres sont ceux desquels les meilleurs lecteurs ont su extraire le plus grande somme de réflexions, de traces en mémoire.
Anne Rabany est membre du CRILJ depuis 1975. Elle a trouvé auprès de cette association les ressources et les accompagnements nécessaires à différents projets qui ont jalonné sa carrière : pour la mise en place des BCD, la formation des personnels lorsqu’elle était Inspectrice départementale puis directrice d’Ecole normale, pour l’animation et le suivi des Centres de Documentation et d’Information des collèges et des lycées, en tant qu’Inspectrice d’Académie, Inspectrice Pédagogique Régionale Etablissement et Vie Scolaire et, actuellement, pour préparer des cours en tant qu’enseignante au Pôle du livre de l’Université de Paris X.