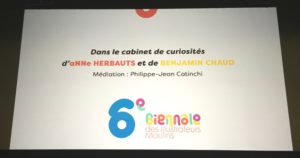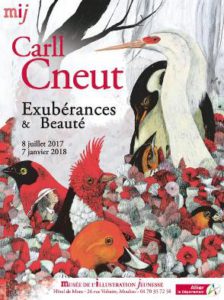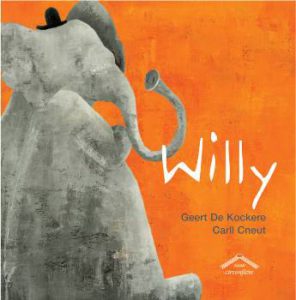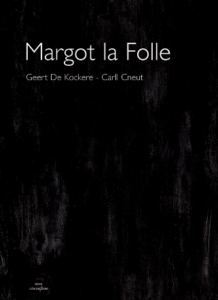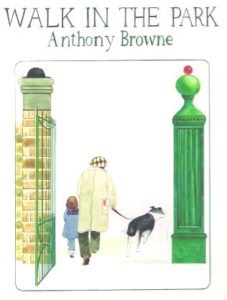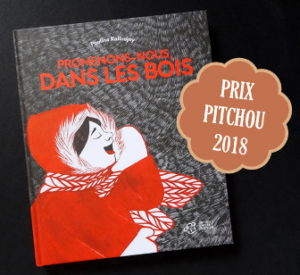.
.
Le samedi 28 septembre 2019, lors de la deuxième journée professionnelle de la cinquième Biennale des illustrateurs de Moulins (Allier), Anne-Laure Cognet, grande connaisseuse de la littérature de jeunesse en général et des albums en particulier, a interrogé Gilles Bachelet, Blexbolex et Joanna Concejo. Nous sommes heureux de pouvoir mettre en ligne, en deux fois, le verbatim intégral de cette rencontre décrypté par Hélène Brunet, adhérente de la section régionale du CRILJ/Midi-Pyrénées.
.
Bonjour à toutes et à tous ! Nous sommes repartis pour une matinée, deuxième ronde de ces journées pro. Avec deux rencontres, une première, tout de suite immédiatement maintenant avec Gilles Bachelet, Blexbolex et Joanna Concejo et une seconde rencontre autour de l’œuvre de Roland Topor. Entre Joanna qui vit dans un forêt de traits, Blexbolex qui se débarrasse bien volontiers du trait et Gilles qui nous fait croire qu’un trait est d’une simplicité enfantine. On ne peut mesurer plus grand écart graphique que celui de nos trois invités. On se demande bien ce qui s’est passé dans la tête des organisateurs ? Vos livres sont extrêmement différents mais parfois les familles les plus éclectiques sont les plus soudées alors va-t-on savoir peut-être qu’au fur et à mesure de la discussion il y aura des passerelles et des petits ponts qui pourront se faire de l’un à l’autre de vos univers. Alors, peut-être avant toutes choses, je vais commencer par vous présenter, Joanna tu as fait les beaux-arts de Poznan en Pologne avant de t’installer en France en 1994 comme plasticienne. Et puis, en 2008, tu as commencé à publier des livres illustrés. Ce qui est très intéressant dans ta bibliographie, c’est que ta route croise celle d’éditeurs européens divers. Le premier était italien, puis après tu as publié beaucoup chez Notari en Suisse, chez Oslo en Espagne, en France au Rouergue et à l’atelier du poisson soluble, et puis, tout dernièrement, tu es revenue à la Pologne avec les éditions Format dont nous allons parler plusieurs fois aujourd’hui. Donc, en tout, tu as publié une quinzaine de livres illustrés, le plus souvent sur les textes des autres, mais pas tout le temps, de ça aussi on reparlera dans cette rencontre. Blexbolex, tu as fait les beaux-arts d’Angoulême puis tu as découvert la sérigraphie ; ce qui a fait que tu as rejoint les éditions Cornélius dès 1996 comme directeur de collection. Sur la scène jeunesse, tu as illustré plusieurs livres chez Thierry Magnier, au Seuil, chez Nathan, mais on peut quand même vraiment dire que ce qui a été la rampe de lancement absolue incontournable commence avec Albin Michel et avec L’Imagier des gens paru en 2008, couronné meilleur livre du monde, j’adore ce titre, je le trouve superbe, et puis, qui va être suivi de Saisons l’année d’après et de Romance faisant ainsi de ta trilogie des imagiers un marqueur assez exceptionnel. On a dû attendre quelques années avant de découvrir deux nouveaux albums ; je me cantonne à la scène jeunesse qui sont Nos vacances en 2017 et Maître Chat l’année dernière dont nous allons parler aujourd’hui. Et Gilles Bachelet.
 Gilles, tu as fait les arts déco à Paris que tu as brièvement, enfin que tu as contourné de belle manière puis tu as publié tes premiers albums jeunesse chez Harlin Quist.
Gilles, tu as fait les arts déco à Paris que tu as brièvement, enfin que tu as contourné de belle manière puis tu as publié tes premiers albums jeunesse chez Harlin Quist.
Gilles Bachelet – Avec une petite participation car c’était déjà la fin des éditions Harlin Quist.
Et puis de toutes façons, c’était un des principes d’Harlin Quist d’avoir des albums collectifs. On était vraiment dans ce grand tournant des années soixante-dix. Mais c’est suite à la naissance de ton fils que tu publies en 2002 Le singe à Buffon et là-aussi tout commence peut-être plus qu’avec les précédentes participations, tout commence pour toi en tant qu’illustrateur jeunesse et évidemment Mon chat le plus bête du monde en 2004 est un personnage qui va t’accompagner, te suivre. Elles sont collantes ces petites bêtes ! Voire même te poursuivre, puisque va sortir incessamment sous peu ce qu’on peut appeler un « track on » de Mon chat le plus bête du monde et qui s’intitule Le casting.
Gilles Bachelet – Pour fêter les 15 ans du chat.
Voilà, on fête les 15 ans
Joanna Concejo – Il est encore vivant ?
Gilles Bachelet – Non, celui-là, non.
Voilà pour cette petite présentation. Donc, devant le grand éclectisme de vos livres, je vais commencer cette rencontre par ce qui est peut-être un point commun en tous les cas ce qui peut être une accroche, on va dire ça comme ça, qui est que vous avez tous les trois commis un conte au moins un conte. Alors, commençons peut-être par Blexbolex puisque je l’ai là sous la main. Tu as publié Maître Chat et Maître Chat, pour être honnête, c’était véritablement une surprise à sa découverte parce qu’il emprunte la ruse et le cynisme à son ancêtre le chat botté. Là-dessus, il est tout à fait conforme mais avec une verve très actuelle et une écriture très théâtrale qui vient rythmer comme ça ce petit objet. Donc, un chat jeté par la fenêtre par son maître découvre la liberté, rencontre un lapin d’une insondable bêtise et poltronnerie ; ce n’est pas le trait premier du lapin. Et alors que le chat envisage le hold-up d’une petite épicerie, il se fait attraper et retourne à son état de chat domestique. Alors commençons par le commencement, tu dédies ce livre à Charles, Michael et Joseph qui sont-ils donc ?
Blexbolex – Charles, c’est Charles Perrault évidemment. Michael Kouliakof, c’est Le maître et Marguerite et il y a un personnage particulièrement odieux mais très drôle qui est un démon qui a la forme d’un chat très volumineux et particulièrement odieux. Et le dernier, c’est Joseph Lada qui est un illustrateur tchèque et auquel la silhouette de mon chat doit beaucoup car il a créé et illustré un livre qui s’appelle le chat Mikes. Au contraire de mon personnage, c’est un chat d’une gentillesse extrême parce que trop naïf. Il ressemble vraiment beaucoup au personnage que j’ai dessiné il a des petites bottes rouges et une casquette donc je me suis amusé à faire un méchant Mikes.
Un méchant Mikes. Le fait est que ces personnages ce chat et ce lapin appartiennent à ton vocabulaire, ce sont des personnages que l’on retrouve ailleurs.
Blexbolex – Oui, ce sont mes personnages amusants que j’ai utilisé le chat et le lapin dans un album qui n’est pas destiné aux enfants qui s’appelle Hors zone ; c’est amusant de ramener ces créatures dans différents contextes sur différentes scènes comme des comédiens. C’est pour ça que j’ai mis ce livre sous forme de pièce de théâtre ; ce sont des comédiens que j’engage pour un temps.
Des intermittents ?
Blexbolex – C’est ça ! De quoi vivent-ils après ? … Je ne sais pas, ils sont chez Gilles ?
Très certainement ! Voilà ce sont des personnages mais le fait est qu’ils s’inscrivent en toi. Ils reviennent à d’autres moments comme un vocabulaire graphique mais ils s’inscrivent aussi dans cette histoire du livre longue. Notamment cette couverture où le chat fait révérence et, du coup, il fait référence. Est-ce que pour toi c’est important de s’inscrire dans cette tradition longue de la représentation, ici du Chat Botté ?
Blexbolex – Oui, bien sûr ! C’est un jeu de réponse culturelle et je tiens à leur rendre hommage c’est-à-dire que sans ces personnages, je n’ai pas de création pratiquement, je n’ai que la fantaisie de les réemployer, de les réinterpréter. Ces personnages pour moi sont essentiels, supérieurs. Par exemple, dans Romance, les personnages comme par exemple Pinocchio, sont des archétypes. Grâce à ces archétypes, je peux m’exprimer mais pour moi c’est ce qu’il y a de mieux dans l’expression de la littérature enfantine. Ça commence par des personnages pour moi pratiquement.
 Gilles, est-ce que pour toi aussi ça commence par des personnages, toujours ?
Gilles, est-ce que pour toi aussi ça commence par des personnages, toujours ?
Joanna Concejo – Ça commence par des envies de dessin déjà. Après, c’est dépendant de chaque album, si vous parlez d’un album en particulier.
Là, ce qui m’interpellait, c’était toutes ces références aux personnages traditionnels.
Gilles Bachelet – Oui, j’en ai aussi dans Madame le Lapin Blanc. Je me réapproprie des personnages d’autres auteurs.
En l’occurrence Lewis Caroll ?
Gilles Bachelet – Qui appartiennent à Lewis Caroll. En inventant d’autres à-côtés, un petit mélange des deux. C’est une facilité pour moi car je n’avais pas particulièrement envie de dessiner Alice parce que je ne sais pas dessiner les petites filles donc j’ai dessiné des lapins. (rires)
Mais s’adosser au texte, s’adosser à cette culture, c’est important aussi ?
Blexbolex – Pardon, j’étais en train de penser au lapin blanc. S’adosser, c’est-à-dire… ? Non, ce sont des personnages qui me sont extrêmement sympathiques qui me donnent des envies de conter mais c’est parce qu’ils ont déjà un vécu littéraire culturel ; ce sont pour moi des personnages familiers.
En tout cas, si j’en viens à ce Maître Chat et à la tradition dans laquelle il s’inscrit, c’est une tradition qui est assez bousculée dans le traitement que tu en fais, que tu lui proposes. Notamment, avec son décor de poubelles, ces objets qui trainent un petit peu à chaque page ces bouteilles, ça n’a rien à envier au Singe à Buffon, il y a un petit problème d’alcoolisme en commun entre les deux albums, avec cette trame noircie comme si l’imprimeur n’avait pas lésiné sur l’encre. Est-ce que cet objet du conte avait besoin d’être un peu patiné ?
Blexbolex – D’être un peu sali, oui ! De toutes façons, le personnage du chat est vraiment méchant. C’est parce qu’il échoue qu’il devient sympathique et donc j’avais envie de donner un arrière-plan relativement sordide à cette histoire qui est exprimé par les déchets, par les traces d’alcoolisme et le fait que l’univers urbain est en train de se construire à ce moment-là avec ses palissades etc. etc. Un univers pas fini, en construction, un peu sale. Là-dessus, je construis mon histoire avec un personnage qui échoue à être totalement méchant, et tant mieux pour lui, et tant mieux pour le lecteur !
Joana, tu as illustré deux contes, Les cygnes sauvages en 2011 et Le Petit Chaperon rouge en 2015. Je vais plutôt m’arrêter sur ce dernier parce que ce Petit Chaperon rouge propose une véritable gageure ; c’est-à-dire que tu as dans le même livre proposé les deux versions du conte : celle de Perrault et celle de Grimm à la queuleuleu. En faisant, par tes images, un lien qui t’est propre et en enchaînant, en donnant l’unité à ces deux textes. Est-ce-que tu peux nous raconter comment ça s’est passé ?
Joanna Concejo – Oui, je vais raconter parce que je m’explique toujours de ce projet.
C’est vrai ? On te demande de te justifier ?
Joanna Concejo – On me le demande mais je ne me justifie pas moi-même. Je justifie les choix d’édition parce que ce livre n’a pas du tout été pensé comme ça. C’est l’édition française qui est comme ça. C’est l’unique version qui a les deux versions du texte. Ce n’est pas du tout mon choix. Donc, je suis obligée de m’expliquer de quelque chose que je n’ai pas décidé. Moi, j’ai dessiné uniquement pour la version des frères Grimm. Normalement, comme tout le monde, pour un seul texte ! Et l’éditeur, lorsqu’il a acheté les droits parce que le livre dans sa version première est coréen. Et bien, il a eu l’idée brillante de mettre les deux textes ensemble !
Ce qui fait que tu es enquiquinée à chaque fois ?
Joanna Concejo – Oui, j’arrive dans les classes et les enfants me disent : « Mais, tu as fait n’importe quoi ! ». (rires) Et moi, je suis entièrement d’accord ! Je leur dis : « C’est n’importe quoi, ce livre ! ». (rires) Ensuite, je leur explique pourquoi il est comme ça. Mais moi, je suis vraiment d’accord avec eux et, je prends la responsabilité de ce que je dis, je n’ai pas voulu ça, mais l’éditeur voulait tellement ça.
L’éditeur a tellement voulu cela qu’il a gagné ?
Joanna Concejo – Il a gagné et, du coup, moi, lorsque je raconte cet album, j’ignore les deux textes. Je tourne les images et je raconte ma version !
Le fait est que tu racontes une version du Petit Chaperon rouge qui t’appartient totalement. Ne serait-ce que parce qu’on n’a jamais vu le petit chaperon rouge et le loup faire une course en sac et que cette image est juste …
Joanna Concejo – Non, mais ce n’est pas forcément parce qu’on ne l’a jamais vu qu’ils ne l’ont pas fait ! (rires)
Absolument ! Joanna sait ça, elle ! Tu as une façon d’illustrer ce conte en partant vraiment sur des détails un peu sur la marge sur la bande. Est-ce que illustrer une scène convenue t’ennuie ? Comment les choses se passent pour toi, sur un texte fondateur que tout le monde connait ?
Joanna Concejo – Non, ça ne m’ennuie pas. Je ne me sentais pas dans quelque chose de convenu, non plus, pas du tout. Et moi, je sais ! Je « connais » exactement où ça s’est passé ! Je plaisante. Quand j’étais petite, j’étais persuadée que ça se passait dans le village de mes grands-parents parce que sinon, comment ma grand-mère aurait-elle été au courant ? (rires)
Très bien, voilà, il nous fallait la clé !
Joanna Concejo – Je demandais des précisions à ma grand-mère. Je lui demandais sur quel chemin, dans quelle forêt exactement, à quel endroit sur ce chemin a eu lieu la rencontre ?, où est la maison de la grand-mère ? Elle jouait le jeu, elle était très rigolote ! Ma grand-mère disait : « C’est là-bas, c’est cette forêt-là. » Donc, sur le coup, je n’imaginais pas tout de suite ce qu’ils pourraient faire ensemble ces deux-là. Mais, non, ce n’était pas un exercice de quelque chose de convenu qu’il faille faire ceci ou cela.
C’est le petit chaperon rouge de ton enfance ?
Joanna Concejo – Oui, exactement avec des lieux de mon enfance, avec presque ma vraie grand-mère, je dis presque parce qu’elle ne fumait pas. Dans le livre, elle fume donc c’est un peu ma grand-mère et ma mère ensemble. Je ne faisais que dessiner ce que j’ai toujours vu à cet endroit-là.
On a éclairci un mystère. En tous cas, les éditeurs font donc n’importe quoi ! Gilles, tout fout le camp chez ma mère l’oie, ça on le savait ! Avec Il n’y a pas d’autruche dans les contes de fées en 2008, c’est un de tes premiers albums qui va attaquer frontalement ce patrimoine des contes. On peut dire qu’on accumule une série de scènes extrêmement drôles sur ces contes du répertoire mais dans l’ensemble tu as d’autres livres qui taquinent le conte de fées d’une manière ou d’une autre ; dont Le chevalier ventre de terre, par exemple, qui est l’histoire de cet escargot procrastinateur et vraiment beaucoup trop lent pour arriver à temps sur le champ de bataille et qui est présenté comme un conte de fées. Alors, ma première question : Est-ce qu’un conte de fées, pour toi, est un bon terrain de jeu ?
Gillles Bachelet – Bien sûr, quand on aime pasticher les choses ! Moi, j’appelle ça jouer avec les affaires des autres, avec les jouets du copains.
Tu me prêtes ton personnage !
Gilles Bachelet – Il faut le faire avec des choses qui sont très connues, sinon ça ne marche pas. Partir d’archétypes, de clichés que tout le monde connait. Par exemple, Le Petit Chaperon rouge, il y en a je ne sais pas combien de milliers de versions ; c’est inépuisable ce qu’on peut faire avec ça. C’est donc l’occasion de faire intervenir les personnages.
De foncer dans le tas. Alors, si on parle des personnages, pour ces contes de fées, tu as quand même pris des animaux, comment dire, des animaux réputés difficiles à dessiner : une autruche et un escargot.
Gilles Bachelet – Ce n’est pas difficile, c’est un animal, pour un illustrateur, qui est du pain béni parce qu’il y a le contraste du noir et du blanc et il y a le contraste des parties toutes emplumées et des parties toutes nues. Et puis, ça a un air crétin quand même ! Il faut bien le dire. Moi, j’adore dessiner des autruches. C’est parti d’ailleurs de cette envie de dessiner des autruches.
 C’est parti de ça. Tu t’es dit, qu’est-ce que je pourrais faire avec une autruche ?
C’est parti de ça. Tu t’es dit, qu’est-ce que je pourrais faire avec une autruche ?
Gilles Bachelet – C’est à peu près ça oui. (rires)
Alors, un des traits distinctifs, dans ta manière de dessiner parce que beaucoup de tes albums reposent sur ces animaux. Un des traits distinctifs, c’est de ne pas rendre ces animaux humains, de ne pas les anthropomorphiser, ne pas faire comme si ils étaient comme nous avec une expression ou quelque chose qui les rapproche de nos visages. Est-ce important pour toi de rester sur ce registre animal ? De garder cette étrangeté ?
Gilles Bachelet – C’est dépendant absolument de mes albums puisque dans Le lapin blanc, ils sont très anthropomorphisés. Ils sont habillés, ils ont des comportements vraiment humains. Donc, il y a toute une échelle de variation là-dessus.
Je sais que Benjamin Rabier est quelqu’un d’important, il est dans un certain nombre de pages de tes albums. Comment envisages-tu le lien avec Benjamin Rabier ?
Gilles Bachelet – C’est une espèce d’affinité qui s’est faite comme ça. Elle vient d’un souvenir d’enfance que j’avais de Benjamin Rabier. Je me suis aperçu après, mais sans que ce soit une volonté délibérée de ma part que je reprenais un peu les mêmes systèmes narratifs, les mêmes systèmes de mise en page que Benjamin Rabier. Des séquences d’actions, puis des images plus fouillées avec des décors. C’est difficiles à dire pourquoi on peut avoir une affinité avec le trait de quelqu’un avec l’univers de quelqu’un.
En tous cas, à l’exposition si vous n’y êtes pas encore allés, vous allez y aller ! Il y a une planche absolument magnifique, un hommage à Benjamin Rabier avec un certain nombre de vaches-qui-rit ; en tous cas, le masque de la vache-qui-rit qui a été adopté par un certain nombre de personnages. Le grand jeu c’est de pouvoir reconnaître les personnages sous le masque. Cette planche a été faite à quelle occasion ?
Gilles Bachelet – Elle a été faite pour une exposition à Montreuil qui s’appelait Jubilo, si je me souviens bien. Il y a quelques années, ils avaient demandé à plusieurs illustrateurs. C’était parti du Château d’anniversaire de Claude Ponti. Il fait référence à toutes ses lectures d’enfance et on a demandé à plusieurs illustrateurs d’imaginer une fête en l’honneur de quelqu’un et dans laquelle il ferait figurer… (rires du public qui regarde la planche projetée) une fête en l’honneur de quelqu’un et dans laquelle il ferait figurer des personnages des lectures de leur enfance. Donc, j’ai choisi Benjamin Rabier puisque c’est pour moi une référence et j’ai fait figurer avec les masques de la vache-qui-rit. Puisque quand je vais dans une classe et que je leur parle de Benjamin Rabier, bien sûr les enfants ne connaissent pas le nom de Benjamin Rabier, et quand je leur dit que c’est lui qui a dessiné la Vache qui rit, bien sûr, ça leur dit quelque chose. Cet espèce d’emblème de la Vache qui rit, je l’ai mis comme masque à tous les personnages des lectures de mon enfance.
Alors, le fait est que dans tes livres, il y a un rapport avec l’érudition. Tu accumules tout.
Gilles Bachelet – Juste. Mais je reviens sur l’anthropomorphisme. C’est surtout dans les histoires d’amour que j’ai cherché à ne pas mettre de traits anthropomorphiques et à ne pas mettre des yeux …
Le Chevalier ventre à terre non plus. Ce sont des escargots. Ils sont habillés mais tu aurais pu leur dessiner de grands yeux à ces escargots et ce n’est pas le cas. L’autruche reste une autruche ; c’est pour ça que je trouve que l’habillement ne fait pas tout dans l’anthropomorphisme. Il y a aussi une manière de représenter le visage. Bref, fermons la parenthèse de ces animaux humains. Juste sur le jeu des références, vous avez une manière très différente de les aborder. Gilles, on peut dire que tu les accumules vraiment d’un livre à l’autre. Bon, alors, Champignon Bonaparte, c’était vraiment la référence à la peinture d’histoire. Mais dans Mon chat, tu glisses de nombreux tableaux de grands peintres modernes. Dans XOX et OXO – je me suis entrainée à dire ce titre – , il y a pas mal de références à l’art contemporain.
Gilles Bachelet – Dans XOX et OXO, c’est vraiment développé car il y a jusqu’à 27 références, par double-page, à des artistes.
C’est votre petit défi de toutes les retrouver ! Mais le fait est que toutes ces références à plusieurs niveaux permettent des jeux de lecture très différents. Est-ce que pour toi c’est ça un album réussi, c’est quelque chose où tu peux t’adresser à tout le monde en même temps ?
Gilles Bachelet – Ce que je cherche à faire, c’est que les références soient un jeu avec le lecteur, souvent beaucoup plus avec le lecteur adulte. Mais ce que je cherche, c’est que ça ne perturbe pas la lecture à un autre niveau de lecture. C’est-à-dire que les références, on les trouve ou on ne les trouve pas, ça n’a pas d’importance. Je veux que ça reste lisible pour un enfant. Champignon Bonaparte, par exemple, on n’a pas besoin de connaître l’histoire de Napoléon. C’est l’histoire d’un sale gosse qui embête tout le monde et qui va finir par se retrouver tout seul. On peut le lire à ce niveau de lecture-là. Après, si on connait l’histoire de Napoléon, on va trouver d’autres références. Ce que j’essaye de faire, c’est que les références ne perturbent pas la lecture.
Pour XOX et OXO, on part pour une planète fort lointaine avec des références à la science-fiction que tu n’avais pas encore réussi à placer ailleurs et tout ça pour arriver au bout du compte à un musée d’art contemporain interstellaire, on est d’accord ?
Gilles Bachelet – Oui.
C’était quand même un sacré détour. Joanna, dans tes albums, le jeu des références est peut-être plus un jeu de mémoire parce que tu glisses souvent des cartes postales.
Joanna Concejo – Quelques fois, j’ai mis des petites références.
Ah ! Oui, mais justement ces petites références, ces photos, ces petits bouts de papier, quel rôle joue ce que tu glisses dans le livre ? Parce que c’est très récurrent ces photos, ces documents et ces petits bouts de papier.
Joanna Concejo – Je sais très peu expliquer mes livres, mais c’est normal parce que j’ai lu dans un livre qui s’appelle La main qui pense que ça peut arriver à des gens de ne pas savoir trop ce qu’ils font lorsqu’ils font les livres. Moi, j’ai besoin du retour du public pour que les gens m’apprennent ce que j’ai fait et que je puisse ensuite en parler. Et maintenant, je me suis perdue. Ah, oui ! C’était la question des références. C’est un petit peu, légèrement obsessionnel. Je peins pour épuiser ce petit filon, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, j’ai une affection particulière, j’ai vraiment une affection énorme pour ces vieilleries. On va dire pour ces vieux bouts de papier, pour ces vieilles cartes, pour ces personnes qui regardent des vieilles photos. Je ne sais pas, je suis encore très très attirée, je ne m’en explique pas. Et puis, moi, je n’ai pas besoin de m’en expliquer, pour quoi faire ? Je n’ai pas besoin de tout expliquer. Jusqu’au bout, lorsque je travaille, je le prends tel quel. Je ne le questionne pas en fait.
J’entends bien. Du coup, laissons de côté tous les petits bouts qui se promènent, certains font référence peut-être à tes archives personnelles et d’autres pas du tout. Laissons-les vivre leur vie dans ces livres-là. En revanche, tu as un rapport aux paysages à la nature morte, à l’herbier qui est extrêmement fort. D’où vient en toi, cet ancrage dans ces paysages ? Est-ce que là encore tu vas me dire la forêt de ma grand-mère …
Joanna Concejo – Bien sûr, je vais le dire !
… mais est-ce qu’elles font références aussi à des peintures classiques, une culture apprise aux beaux-arts ? Enfin, voilà ! Comment les choses s’ancrent pour toi dans les livres ?
 Joanna Concejo – C’est encore une fois quelque chose que je n’arrive pas trop à bien démêler. C’est assez emmêlé, mais, moi, ce fouillis me va. Donc, je ne cherche pas à savoir pourquoi. J’aime les paysages. Je pense que ça y est pour quelque chose, l’environnement dans lequel j’ai vécu jusque assez tard. J’ai quitté ma campagne chérie de manière un peu définitive, pas tout à fait, mais de manière un peu plus significative lorsque j’avais déjà vingt ans. Donc, ça faisait un bout de temps que je n’étais entourée que de paysages, de forêts, etc. De plus, j’ai une fascination pour la peinture. Venant d’où je viens, de la Pologne, nous avions, quand j’étais petite, une grande influence de l’Est. Ce n’est pas un scoop ce que je vous dit là. (rires) J’étais fascinée par des reproductions des peintures russes, sur les timbres, en minuscule. Je pouvais passer des heures sur les albums de timbres avec les reproductions de tableaux de paysages. J’adorais ça. J’avais l’impression de rentrer dedans. Si il y avait un chemin, et bien, j’avais vraiment l’impression d’aller sur ce chemin dans des timbres alors que c’était vraiment tout petit. C’était une fascination que j’avais et que j’ai encore quand quelque chose est petit. Surtout un paysage, ça me fascine. Je suis scotchée. Il y a certainement d’autres références que je ne connais pas, que j’ai laissées entrer en moi sans faire attention, ça s’est mélangé.
Joanna Concejo – C’est encore une fois quelque chose que je n’arrive pas trop à bien démêler. C’est assez emmêlé, mais, moi, ce fouillis me va. Donc, je ne cherche pas à savoir pourquoi. J’aime les paysages. Je pense que ça y est pour quelque chose, l’environnement dans lequel j’ai vécu jusque assez tard. J’ai quitté ma campagne chérie de manière un peu définitive, pas tout à fait, mais de manière un peu plus significative lorsque j’avais déjà vingt ans. Donc, ça faisait un bout de temps que je n’étais entourée que de paysages, de forêts, etc. De plus, j’ai une fascination pour la peinture. Venant d’où je viens, de la Pologne, nous avions, quand j’étais petite, une grande influence de l’Est. Ce n’est pas un scoop ce que je vous dit là. (rires) J’étais fascinée par des reproductions des peintures russes, sur les timbres, en minuscule. Je pouvais passer des heures sur les albums de timbres avec les reproductions de tableaux de paysages. J’adorais ça. J’avais l’impression de rentrer dedans. Si il y avait un chemin, et bien, j’avais vraiment l’impression d’aller sur ce chemin dans des timbres alors que c’était vraiment tout petit. C’était une fascination que j’avais et que j’ai encore quand quelque chose est petit. Surtout un paysage, ça me fascine. Je suis scotchée. Il y a certainement d’autres références que je ne connais pas, que j’ai laissées entrer en moi sans faire attention, ça s’est mélangé.
Alors, puisqu’on parle du minuscule. Je voudrais qu’on parle du livre qui vient de sortir, Ne le dis à personne, où tu racontes à deux voix avec ton mari Rafael, vos enfances respectives, un jeu de ping-pong entre vous deux. Vos textes rebondissants les uns sur les autres : toi ton enfance en Pologne, lui son enfance en France dans une famille d’origine espagnole et tes images font le lien entre vos deux textes. Le livre est extrêmement touchant, les textes sont très beaux. Quand toi tu te plains d’un manteau hideux, lui raconte des séances d’essayage de pantalon, évidemment pendant la meilleure émission télé. Enfin, voilà, c’est toutes ces petites choses de l’enfance que vous racontez l’un sur l’autre mais graphiquement le trait que tu fais c’est toi qui illustre l’ensemble du livre. C’est de vous représenter, j’imagine tous petits, tous minuscules, perdus sur cette page et souvent de diviser la page en deux. Comment as-tu voulu interpréter vos enfances ? Parce que là, c’est vraiment ce retour aux sources directement, frontalement.
Joanna Concejo – Je ne les ai que depuis hier. Heureusement, merci aux enfants que j’ai rencontrés, qui m’ont posé beaucoup de questions, qui m’ont obligée à penser sur la question. Alors, pourquoi minuscule, parce que comme je me suis servie pas mal de photos : des miennes et des siennes, souvent les photos de l’époque ne sont pas géantes. Elles sont assez petites. Les gens, sur ces photos-là, sont assez petits. Et moi, j’ai voulu garder cette mesure. Donc, si, sur une photo, j’étais toute petite, alors je la dessinais pareil, toute petite. Et maintenant, le contexte, c’est que je suis toute petite, perdue dans cette feuille très grande. Quand les enfants, hier, m’ont demandé pourquoi tu caches une partie des images, pourquoi on ne peut pas regarder derrière, on veut voir le visage de cette petite fille, on ne peut pas le voir ça, nous énerve. Moi, je n’avais pas d’explication. Mais j’en ai une, on va dire provisoire pour aujourd’hui … (rires)
C’est une bonne idée, merci.
Joanna Concejo – C’est provisoire parce qu’elle pourra peut-être encore évoluer changer. Je me suis dit que c’est un peu comme avec les souvenirs, tout n’est pas net et tout n’est pas découvert. C’est plutôt qu’il y a une partie qui est tellement couverte qu’on n’arrive plus trop à voir. C’est vrai, il y a une petite frustration du fait de ne plus pouvoir arriver à tout voir clair, ou à découvrir ces parties cachées et c’est probablement sorti un peu tout seul dans le dessin ; le fait que celui qui regarde ait aussi la frustration : eh bien non, il ne verra pas le visage de cette petite fille qui est caché par une autre partie de l’image !
Parce qu’on n’a plus accès à ses souvenirs ?
Joanna Concejo – Pas la totalité en tous cas ! Enfin, moi, je suis comme ça, je ne sais pas vous ? Je sens que c’est un sentiment partagé.
(Moulins – septembre 2019)

.
Hélène Brunet habite et travaille dans le Volvestre, territoire rurbain au sud de Toulouse. Elle est enseignante dans le 1er degré et a, cette année, une classe de cours préparatoire. Elle a toujours intégré la littérature de jeunesse dans sa pratique pédagogique et a réalisé plusieurs classes lecture à la Salle du Livre du CADP de Rieux Volvestre. Elle est depuis deux ans adhérente au CRILJ/Midi-Pyrénées où elle occupe le poste de trésorière adjointe. Elle s’est investi dans les projets menés par le CRILJ au plan national, notamment, en 2019, celui autour des représentations de la pauvreté en littérature de jeunesse. C’est une fidèle des rencontres avec les auteurs-illustrateurs qu’invite le CRILJ/Midi-Pyrénées Elle apporte son concours, en 2020 et 2021, au projet Habiter. Hélène Brunet est l’une des quatre boursières ayant bénéficié d’un « coup de pouce » du CRILJ à l’occasion de la cinquième Biennale des illustrateurs de Moulins.
.
photos : André Delobel
.
.
.
.
.