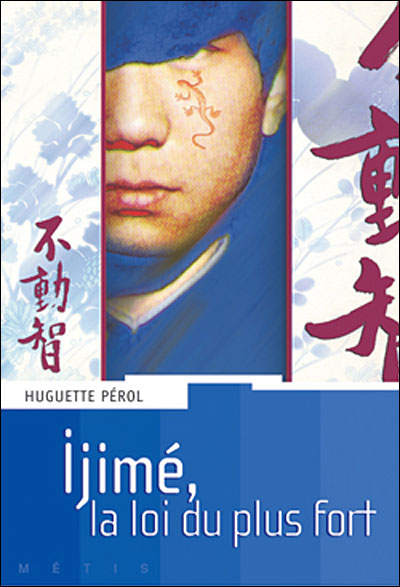Tout est excessif dans l’image mythique que l’Occidental se construit aujourd’hui du Japon frappée encore par la culpabilité qu’ont laissée les bombes d’Hiroshima et de Nagasaki, inquiétée par l’essor d’un Etat en plein expansion, notre imagination s’emporte et veut découvrir dans cette culture lointaine une étrangeté à la mesure de l’horreur que nous avons perpétrée. Réalité ? Pure fiction ou représentation correcte d’un désir de revanche de l’Orient mystérieux sur un Occident jusqu’ici rassuré par sa technique et son économie ? Il est difficile de répondre et il faut laisser la place aux témoignages.
En livrant ces derniers, les récits japonais, eux-mêmes – qu’il s’agisse de films, comme l’Empire des sens, comme le récent et splendide Rêves d’Akira Kurosawa obtenant la palme d’Or à Cannes, ou des romans comme Narayama de Shichiro Fukazawa (Folio Gallimard) – qui sont bien de nature à accentuer l’idée d’une violence et d’une frénésie exceptionnelles qui, par leur qualité fantasmatique, dépassant de loin un projet purement réaliste. Que dire ainsi des minutieux constats et des implacables machines que représentent Le marin rejeté par la mer et Le Pavillon d’Or de Yukio Mishima ? De manière symétrique dans ces deux histoires, la mise à mort du marin programmé par un groupe d’adolescents et l’incendie du Temple provoqué par un jeune héros qui se détruit par ce geste sacrilège, relèvent d’une étude de la pathologie sociale. Comme le précise la préface du Pavillon d’Or, c’est bien comme l’acte d’un « psychopathe de type schizoïde » qu’est jugé le crime de l’incendiaire. Et l’envahissement de l’imaginaire du malade par l’image du feu dévastateur n’a d’égal que la lente montée de la neige salvatrice qui recouvre les vieillards attendant la mort dans la montagne de Narayama.
Le scénario de l’élimination est planté chaque fois dans un décor fortement chargé des archétypes de « l’imagination matérielle », et ces deux obsessions d’un énigmatique « empire des signes » – selon la formule de Roland Barthes – sont rassemblées aussi d’une manière significative dans deux « rêves » d’Akira Kurosawa. Il semble donc que la description des relations sociales commandées par les rites et la tradition – et la présentation des conflits qui en résultent – conduisent à l’édification et à la diffusion d’une vision d’un pays légendaire dans lequel les forces naturelles se conjuguent avec les contraintes humaines pour offrir à la vie quotidienne une dimension particulièrement tragique. Huguette Pérol, lors d’un séjour qui a précédé l’écriture de La loi du plus fort, n’a pu qu’être sensible aux tensions de ce Japon mythique subissant les contrecoups d’une rapide mutation industrielle.
Son témoignage prend alors la forme d’un récit, récemment publié dans la collection Les Maîtres de l’Aventure des Editions Rageot en 1989, qui laisse libre cours à tous les fantasmes que suscite la Différence. Ce texte fait suite à d’autres œuvres (ainsi, le Pays des femmes oiseaux, situé au Koweit) de la romancière, grande voyageuse qui a vécu en Afrique du Nord, au Moyen Orient et au Japon. C’est donc ses impressions que nous recueillons pour juger d’une civilisation qui nous intrigue et qui nous intéresse autant à titre documentaire que par comparaison avec l’évolution de notre propre société. Dans la réflexion qu’elle conduit sur le statut de l’enfant moderne, Huguette Pérol, par ses œuvres antérieures dans le domaine de l’édition pour la jeunesse, nous parait, d’autre part, fournir des gages quant à la validité de l’enquête et de l’aventure qui nous sont proposées. Le fait que l’exploration de la société japonaise soit absorbée par le moyen d’un jeu est aussi de nature à redoubler notre attention. Le jeu et les pratiques ludiques, comme le suggérait Roger Caillois, ne sont-ils pas des éléments précieux dans la démarche d’une sociologie critique ? Il y a là enfin un exotisme qui rejoint celui du film japonais L’empire des sens dans lequel, très curieusement, se manifeste aussi une violence impitoyable dans le ludisme amoureux.
Et, de fait, c’est l’affirmation immédiate de cette violence qui semble avoir frappé Huguette Pérol dans son reportage sur la vie japonaise :
« Tokyo, capitale orgueilleuse d’un des pays les plus riches du monde, Tokyo, deux fois ravagée par le séisme et par la guerre et deux fois reconstruite, mais condamnée à travailler d’un bout à l’autre de l’année, comme le requin qui doit nager sans relâche s’il ne veut pas mourir » (p.7).
L’image du « requin » est d’une force extrême au début du récit : par ses connotations négatives, elle est de nature à commander d’emblée la vigilance critique du lecteur. Elle rejoint celle de « l’hydre à mille faces multiples respirant d’un même souffle et me dévisageant d’un même regard » (p.5), image déclenchée dans le style de la narratrice par la vision d’un groupe de collégiens. De toute évidence, c’est un malaise très fort qu’Huguette Pérol souhaite exprimer avec ces archétypes, malaise que le spectateur de Rêves ressentira, de même, devant le cauchemar que représente « Le mont Fuji au rouge » montrant la foule terrifiée par une éruption volcanique dans le film de Kurosawa. Ce malaise est celui d’une société toute entière tournée fondée sur la puissance, sur la lutte pour l’existence et la domination et dont le jeu de « l’Ijimé » est la projection révélatrice. Ce jeu qu’elle nous explique dans son prologue, « tient de la corrida et de la chasse à courre ». Le mot « Ijimé » signifie « maltraité un être en état de moindre défense » : ainsi, à l’école, par exemple, un groupe d’enfants choisit un camarade et ‘la victime désignée est enserrée de toutes parts, isolée, harcelée, elle se débat, s’épuise et finit par se rendre » (p.6).
Le jeu résume donc et révèle l’essence même d’une culture surgie dans un milieu naturel très hostile qui dramatise l’existence et légalise des conduites dont Huguette Pérol souhaite affiner l’analyse : « pour ces enfants nés sur une île fouettée par les typhons et secouée par les tremblements de terre, grandis dans un espace exigu où le béton dispute son espace à la forêt vierge, la force indispensable à la survie a pour conséquence l’élimination de ceux qui sont incapables de se défendre » (p.6).
Comme La violence et le sacré de René Girard montrant la cohérence qu’une société retrouve dans le sacrifice d’un bouc émissaire, La loi du plus fort est donc le démontage d’un mécanisme subtil qui atteint l’individu dans son enfance même. La fragilité de cet âge va expliquer que le jeu tourne mal et transforme le fantasme en réalité. Perspective qui pourrait paraître fantaisiste et « romanesque », mais que l’excès japonais rend plausible. Perspective qui est justifiée par un fait divers relaté par les journaux – tout comme l’a été celui du Pavillon d’Or de Moshima inspiré par le quotidien Yomiyuri – et qui sera encore plus brutalement confirmée par l’implacable remarque finale de l’épilogue :
« J’ai lu dans le Yomiyuri d’hier soir qu’une jeune fille de quatorze ans s’était jetée du quinzième étage pour mettre fin aux persécutions de ses camarades » (p. 153).
C’est donc à la mise en scène d’un assassinat que nous allons assister : au meurtre d’un enfant perpétré par des camarades qui se voient autorisés par le monde adulte à mener jusqu’au bout une élimination rituelle. Le fantasme classique « on tue un enfant » investit ici un contenu social concret et, comme dans la transe chamanique, est facteur d’équilibre pour des individus dont la solidarité repose sur l’exorcisme de la faiblesse, comme élément décisif du mauvais fonctionnement social qui les met eux-mêmes en danger.
La difficulté de l’entreprise romanesque résidait pour Huguette Pérol dans le choix d’une stratégie narrative qui rende vraisemblable un tel compte rendu et la romancière a choisi ici le parti qui exigeait la pénétration la plus déliée : celle de l’identification à l’autre. Ce n’est pas le moindre paradoxe de son récit que d’être constitué d’une constellation de points de vue représentant l’éclatement du point de vue subjectif que pouvait avoir le narrateur du Pavillon d’Or, et éclairant le déroulement de l’action par la vision partielle que chaque participant en possède. Comme dans un roman policier, chaque témoignage, dans toute l’innocence et dans l’aveuglement de sa subjectivité, est ainsi le facteur décisif de l’intérêt d’un lecteur appelé à décrypter les ambigüités de la personne. En resserrant l’intrigue autour du point de vue central du jeune Youkio Kimura qui est éliminé au dénouement, Huguette Pérol enfin réalise, en matière d’écriture, une version d’écriture, une version originale du type de récit policier créé par les romanciers Boileau et Narcejac et appelé « roman de la victime » : la mort de Youkio est le couronnement d’un procesus complexe dont elle représente l’éclaircissement.
La double implication : la victime et le moi divisé
La dénonciation d’une idéologie de la force s’annonce d’emblée dans le roman par l’intermédiaire du récit de Takéo, le chef de classe qui va décider « l’élimination » (p. 16) de Youkio Kimura, « la brebis galeuse ». Cette élimination est présentée comme une sorte de purification :
« A quoi servent l’intelligence et la beauté quand on manque de caractère et de force », pense Takéo (p.16) en réfléchissant au cas de son camarade. Car une des contradictions de Youkio est de vouloir s’intégrer au système qui va le détruire.
Le modèle est ici celui du rapport du samouraï et se son Shogun (p. 10), une relation que Youkio essaie d’instaurer avec celui qui le méprise. En réalité, comme tous les membres de la société japonaise, cet enfant représentatif est entraîné dans la frénétique course pour la réussite qui fonde le prestige sur le succès financier et intellectuel :
« C’était un élève travailleur. Trop peut-être ! Je me disais : s’il obtient les meilleures notes, c’est qu’il s’en donne la peine… Il se rongeait les ongles, pensant aux efforts qu’il aurait à faire pour entrer à Todaï, l’université de Tokyo, la plus cotée, celle qui ouvre les portes de la fortune et de la considération, le rêve des parents, le cauchemar des enfants » (p.8).
Huguette Pérol a mis ici en avant un enfant semblable à ces « jeunes garçons, de petite taille, délicats, bons élèves à l’école » qui peuplent le récit Le marin rejeté par la mer de Mishima (p. 55). Ce héros apparaît comme le double littéraire de Noboru dont le beau-père est immolé par la bande dans ce dernier roman. Mais Youkio, qui, en réalité, porte – significativement peut-être – le même prénom que Mishima, tout en recevant, lui aussi, les compliments de ses professeurs, à la différence de ce qui se passe dans Le marin rejeté par la mer se trouve dissocié d’un groupe qui n’est pas exclusivement constitué de « garçons de bonne famille ». Son exclusion retourne contre lui la « nécessité du sang » de la victime humaine qui soude le groupe dans le récit de l’écrivain japonais ; en bref, Huguette Pérol insiste plus clairement sur les réalités économiques structurant les rapports des enfants : en ce sens, le morcellement des points de vue permet à la romancière d’éviter l’enfermement d’une narration subjective unique, semblable à celle qui place le lecteur de Mishima dans la dépendance d’une complicité exclusive. La distance critique ainsi introduite lui donne alors les moyens de dénoncer l’idéologie de la virilité et de la force à laquelle Mishima, on le sait, adhérait dans la vie et l’écriture féminine se présente alors comme une « lecture » ironique du culte de ce pouvoir masculin dont l’écrivain japonais s’est fait le champion.
L’erreur de Youkio consiste donc à entrer dans un jeu qui aliène sa liberté en l’obligeant à embrasser des intérêts contraire à sa nature. Dès le début, cette idée d’un « faux Moi » de l’enfant – au sens où Winnicott emploie le mot – est suggérée par les rapports que le garçon essaie d’instaurer avec un de ses camarades, Masato, un « bon gros qui n’ira pas très loin dans ses études, qui s’intéresse aux jeux de hasard, aux images érotiques, à tout ce qui est étranger à Youkio » (p. 8.). De même, son désir de fréquenter le « chef » qu’il suit « comme un chien à la sortie de l’école » (p. 9), son imitation de celui-ci (« c’était moi version singe » pense Takéo) et enfin l’orgueil de participer au défilé annuel à Asakusa et de porter une lourde « pagode » (p. 11) provoquent rapidement la révélation d’une fêlure significative : incapable de supporter les coups que ses camarades lui infligent indirectement pendant l’épreuve, Youkio se met à gémir et à pleurnicher et abandonne lamentablement ses prétentions. Comme ses camarades le font remarquer, il a « une vraie peau de fille » (p. 15) : cette remarque est inspirée par les intolérances de l’adolescence et par des ambigüités sexuelles qui pourraient rappeler les perversités du Désarroi de l’élève Törless de Robert Musil ; elle prend tout son sens dans le point de vue du père de l’enfant qui considère la période de cette adolescence comme une faiblesse. Car le drame réside là : dans les ambitions et l’indifférence du père de Youkio, lui-même engagé dans la course pour le pouvoir qui l’éloigne de sa famille (il sera nommé directeur), tout en lui conférant dignité et honneur, et dans la tendresse refoulée d’une mère, elle-même, victime consentante de son mari et d’un système qui la transforme en esclave soumise.
Deux voies d’offrent donc à Youkio : soit celle de l’artifice et des contorsions dans le mimétisme général de l’état hiérarchisé (et l’on songe ici aux héros de Dostoïevski entraînés dans « l’abstraction » et la fausseté que dicte le seul respect de « l’idée » aliénante) ; soit dans le sens d’une recherche de la vraie nature qui l’habite et dont il a une première révélation avec sa cousine Tetsouko. De nouveau, l’image d’un personnage dostoïevskien – la Sonia de Crime et Châtiment, par exemple – s’impose comme la suggestion équivalente d’une authenticité des rapports que Youkio pourrait trouver dans le respect de son entourage social. Le recours à l’amour dans le repliement narcissique que représente l’union fusionnelle ave sa cousine à la campagne près d’une grand-mère compréhensive, signifierait pour Youkio le salut et la vie simple dans le décor de l’enracinement traditionnel.
Cette impression est corroborée et exprimée par Tetsouko qui a recueilli une partie des confidences de son cousin (« Je ne suis pas un héros » (p.27), lui a-t-il dit), pendant les vacances dans le lieu idyllique de Chuzenji ; là, au cours d’une promenade dans les bois, un orage a éclaté sur les bords du lac romantique et Youkio a laissé paraître un aspect de lui-même qui contredisait les affirmations de son propre père. Alors que ce dernier n’hésitait pas à affirmer que son fils « était un timoré », le jeune homme s’est révélé courageux.
« Youkio qui haïssait la violence, accueillait sans révolte les déchaînements de la nature… Je m’étais rapprochée de lui, tremblante comme une feuille… Youkio a ôté son blouson, l’a mis sur mes épaules… Le déluge lavait son angoisse, faisait de lui un être neuf », note Tetsouko (p.30).
L’image chevaleresque qui s’impose dans cette révélation n’échappe pas non plus au romantisme non moins échevelé de Tetsouko :
« Sa bouche s’est entrouverte comme pour mordre et il m’a repoussée, effrayé par cette force qui montait en lui et qu’il ne parvenait pas à maîtriser » (p.31) remarque l’adolescente qui interprète ensuite ses conseils comme un « ordre » auquel elle obéît volontiers.
Mais Youkio, en réalité, est un être qui est placé dans une dépendance absolue à l’égard de sa mère par l’absence virtuelle du père au foyer. Cette mère Emiko, l’a « servi comme un petit seigneur » (p.47) et dans une double implication tout aussi aliénante que celle qui lie Youkio à son père, l’enfant a servi de compensation aux manques affectifs de celle-ci, lui « rendant douce » sa petite enfance.
Ainsi est disposée la machine infernale : ressemblant de plus en plus à sa mère physiquement, (comme le père de l’enfant le remarque), enfermé dans les causes et les douceurs d’une affection maternelle envahissante qui lui fait haïr la violence sociale dont les relations parentales sont l’exacte projection (Youkio, transformé un instant seulement en « voyeur », comme le Noboru obsessionnel du Marin rejeté par la mer, surprend cette intimité à travers les cloisons légères de la maison, p.82), le héros-victime ne peut qu’imiter son père et refouler ses sentiments : en sauvegardant sa réputation de bon élève et en participant « à l’affrontement pour la première place » (p.54), il s’identifie à celui-ci, mais en même temps, il ruine ses ambitions, comme le remarque Nakaï par « sa prétention dissimulée sous une modestie hypocrite » (p. 39). Cette machine plantée dans un décor de rêve va enfin s’emballer quand « l’instinct de chasseur » du groupe a été éveillé rappelant les excès des enfants retournés à la vie sauvage de William Golding dans Sa Majesté des Mouches et quand :
« Bientôt, les cerisiers tourneraient au rouge cendré, les érables rependraient des tons de cuivre (p. 31). L’image des cerisiers, – arbres de guerriers, dans l’iconographie traditionnelle – dépasse ici l’évidence du code social pour retrouver le merveilleux onirique qui n’est pas sans rapport avec celui de « l’enfant aux pêchers » d’Akira Kurosawa.
La mise en scène ou la mise à mort : la grande vague d’Hokusai
La référence aux masques du théâtre Kabuki est donnée à plusieurs reprises dans le roman d’Huguette Pérol et la grande réussite de ce récit est bien de transporter jusqu’au délire les visions hiératiques qui vont entraîner l’anéantissement du héros dans un jeu pervers de mimes. Ainsi Youkio, rencontrant l’image obsessionnelle de sa mort, ne pourra qu’accepter le rôle qui lui est suggéré.
Il n’est pas surprenant que la première image reçue par l’enfant soit celle d’une mort féminine, celle d’une « cousine » venue faire du ski à Chuzenji et qui s’est perdue dans la neige : « on l’avait découverte au matin, appuyée au pied d’un arbre, elle avait l’air de dormir » (p.23). Le récit jalonné de signes funestes transpose dans le domaine oriental la nécessité tragique qui conduit l’enfant à s’identifier à une morte : c’est bien de froid que périra Youkio séduit par une Reine des neiges qui partage la douceur de celle d’Akira Kurosawa dans le rêve de « la tempête de neige ». Mais les camarades de l’enfant ont aussi cruellement mimé ses funérailles dans une cérémonie parodique qui a eu l’aval du professeur en classe. Cette mise en scène redoublant le meurtre du lézard, animal favori de Youkio (lointain écho du meurtre initiatique du chaton dans Le Marin rejeté par la mer ?) a provoqué sa fin tout en la préfigurant. Le lecteur se trouve donc confronté à un rituel mortuaire où la poésie traditionnelle est condensée en des phrases et un scénario que n’aurait pas reniés Mishima, chantre de « l’unique » et de son désespoir :
« Les morts ne parlent pas, ils ont d’autres moyens de s’adresser à nous, de faire sentir leur présence… Les couleurs des fleurs sont brouillées sous la neige, tellement qu’on ne peut les voir, mais leur parfum qu’on respire révèle leur présence… » (p.106).
L’opposition de deux cultures confère alors à La loi du plus fort la portée d’un plaidoyer passionné en faveur d’un humanisme centré sur la notion de personne. La destruction de l’enfant dans l’engrenage des relations sociales qui impliquent l’acquiescement masochiste de la victime – alternative de la provocation « orgueilleuse » dont Tokyo est donnée comme modèle – alimente ici la critique générale des sociétés hiérarchisées régies par le principe de compétition paroxystique. Roger Caillois employait, à ce propos, le terme « d’agon » qui a des résonnances sinistres évoquant non seulement la lutte, mais l’agonie. Aussi, il faut lire le récit d’Huguette Pérol comme un conte d’avertissement relayant les remarques de Winnicott sur le faux Moi et sur le fantasme d’effondrement, sur la pulsion de mort qui commande les sociétés du Moi divisé. Le « roman familial », dans son emphase devient représentatif et incarne le tragique un peu grimaçant de notre époque même, d’une époque où les vieillards improductifs (la grand-mère de Youkio) sont sacrifiés, comme l’héroïne symbolique de Narayama. Et Youkio mourra dans une solitude semblable à celle du personnage de Fukazawa. En ce sens l’œuvre d’Huguette Pérol illustre parfaitement avec le jeu de l’Ijimé le principe central de l’ethnopsychiatrie complémentariste de Georges Devereux, selon lequel tout rite, comportement ou jeu dans une société donnée s’inscrit comme la réalisation de conduites n’ayant qu’un statut fantasmatique dans une autre.
Si l’enfant dans sa lutte éphémère rêve de cataclysme et de lézard, comme le héros de La Gravida, récit de Jensen analysé par Freud, ce n’est pas pour une résolution heureuse de son aventure : pas de Zoé qui l’arrache à « l’orgueil’ de l’abstraction sociale dans son cas, pas de jeune fille qui puisse le sauver. Tetsouko, vrai « papillon » narcissique, n’a pas la force d’une Gerda capable d’arracher ce Kay oriental à l’emprise de la Reine des Neiges et de proposer la fin heureuse d’Andersen. Il semble ici que le conte de ce dernier soit mentionné (p.51) dans l’histoire autant pour fournir un contre-point dramatique que pour exprimer l’amour porté à un pays cruel par la romancière et ses personnages. Car le Japon, en définitive, est le lieu d’une emphase baroque dont la neige traduit le brutal et progressif soulèvement. La montée de celle-ci est signe de pureté et principe de mutation et rejoint la rhétorique de la temporalité et de la fragilité existentielles. Comme le dit Youkio :
« Je suis un oiseau qui passe, une cascade qui vit et meurt dans l’instant (p.57) »
ou comme l’affirme son père :
« La vie est une lame de fond qui s’élève, s’enroule sur elle-même et s’anéantit sans laisser de trace (p.80) ».
La vague gigantesque d’Hokusai semble surgir du fonds culturel japonais pour convulser la conscience des héros, avec l’acquiescement final, lorsque « la neige » ou les « papillons blancs qui se détachent des cerisiers en fleurs » paraissent garantir le sentiment de l’immortalité de l’homme. Splendide élévation dans la perspective tragique de l’Occident, mais qui rendent plus aiguë aussi la destruction d’un unique enfant… De la rencontre contradictoire de ces visions s’impose en creux le désir d’une invincible fureur de vivre. En définitive, l’enfant assassiné, envers et complément de l’enfant-roi triomphant – beau « jouet neuf » transformé en pitoyable « mécanique », et, à l’image de son père, mort vivant parmi les vivants – n’aurait pu être sauvé que par le souffle d’un humanisme qui se veut adhésion totale au mouvement du monde. Comme le suggère la romancière dans ce qui nous paraît la plus belle phrase de son roman l’important alors est de s’abandonner à « une sensation qui se passe ailleurs que dans le corps », à « une mouvance comparable au vent, à la brume, à l’esprit mystérieux qui ébranle parfois la terre sous nos pieds (p. 134) ». Ce souffle est celui du Personnalisme qui conduit à l’unité inaliénable du Sujet triomphant de l’indistinction des foules.
( texte paru dans le n° 39 – juin 1990 – du bulletin du CRILJ )
Professeur de littérature comparée et spécialiste de littérature de jeunesse, fondateur, en 1994, en relation avec les universités et les professionnels des métiers du livre, de l’institut Charles Perrault à Eaubonne (Val-d’Oise), très actif au plan international, Jean Perrot a dirigé de multiples travaux sur le conte et la littérature pour la jeunesse, organisé colloques et formations, publié de nombreux ouvrages parmi lesquels L’humour dans la littérature de jeunesse (In Press. 2000) Du jeu des enfants et des livres (Cercle de la librairie, 2001), Mondialisation et littérature de jeunesse (Cercle de la librairie, 2008). Il est le coordinateur, avec Isabelle Nière-Chevrel, du Dictionnaire du livre et de la littérature de jeunesse en France, à paraître en 2012 au Cercle de la librairie.